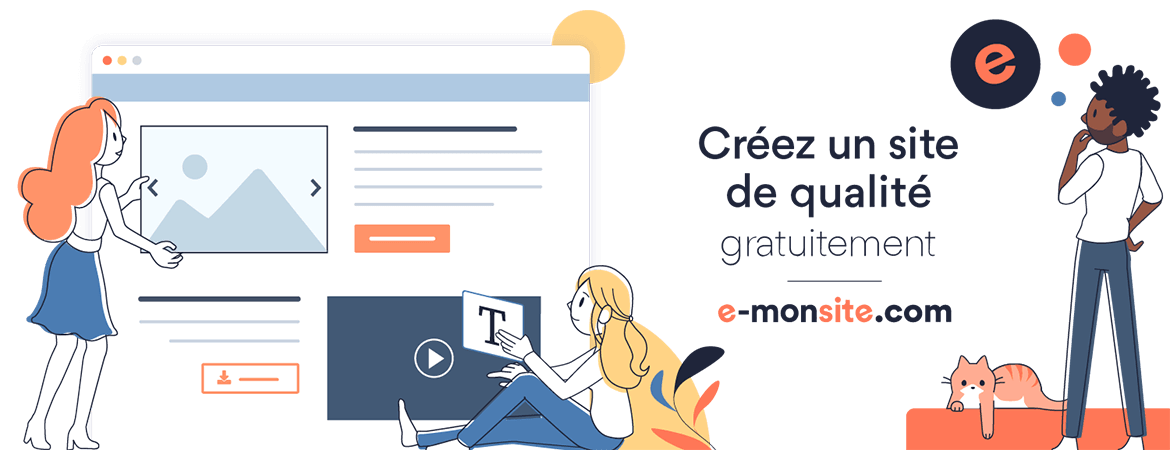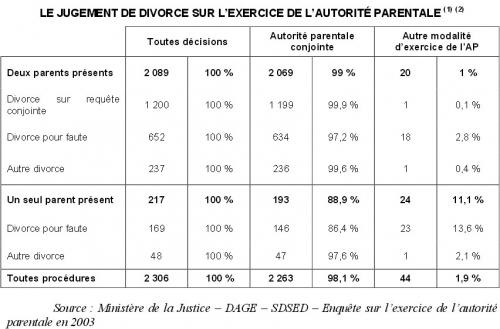INTÉRÊT DE L’ENFANT, AUTORITÉ PARENTALE ET DROITS DES TIERS
PREMIÈRE PARTIE
A. DONNÉES SOCIOLOGIQUES RELATIVES AUX RÉALITÉS FAMILIALES
Avant de revenir plus largement sur le droit et la pratique de l’autorité
parentale, il est en effet essentiel d’avoir la vision la plus large plus possible de la
famille française d’aujourd’hui.
1. La famille française en 2009
Depuis une quarantaine d’années, comme dans la plupart des sociétés
occidentales, la famille française a connu des évolutions de grande ampleur dont
témoignent les données de notre démographie.
a) Le déclin du mariage, comme fondement de la constitution de la
famille
Selon l’Institut national des études démographiques (INED), alors que
394 000 mariages avaient été célébrés en 1970, on n’en comptait plus que 273 500
en 2008. S’agissant du premier mariage, l’âge moyen au moment de sa célébration
a augmenté de plus de cinq ans et demi depuis 1970 : il est en 2008 de 31,5 ans
pour les hommes et de 29,5 ans pour les femmes. Aussi, alors que seulement une personne sur dix née entre 1945 et 1950 ne s’est pas mariée, c’est le cas de
trois personnes sur dix au sein de la génération née en 1970.
Ce déclin du mariage s’accompagne d’un développement de l’union libre :
celle-ci est plus fréquente et dure beaucoup plus longtemps qu’auparavant. Quand,
au début des années 1970, un couple sur six débutait son union par une phase
d’union libre, neuf couples sur dix aujourd’hui sont dans cette situation. En 1975,
la moitié des unions libres se transformait en mariage dans les deux ans ; ce n’était
plus le cas que d’une sur trois en 1985 et d’une sur cinq en 1995. L’union libre
devient ainsi une forme de vie commune parfaitement banalisée, qui ne concerne
plus seulement une population marginale ou très jeune, mais qui est au contraire
particulièrement répandue chez les hommes et les femmes ayant déjà fait
l’expérience d’une rupture d’union.
Désormais, la cohabitation n’est plus, comme dans les années 1970,
généralement suivie d’un mariage lorsque le couple désire un enfant ou en attend
un ; le mariage n’est plus considéré comme un préalable indispensable pour
accueillir un enfant. Aussi la conséquence la plus visible de ce développement de
l’union libre et de son allongement est la multiplication des naissances hors
mariage, qui représentent 51,6 % % de l’ensemble des naissances en 2008. Ainsi,
parmi les enfants nés hors mariage dans les années 1990, seuls 40 % verront leurs
parents se marier et seulement deux sur trois avant l’âge de six ans.
La proportion de 51,6 % des naissances hors mariage est relativement
élevée en Europe occidentale et place la France dans les premiers rangs de cette
pratique, derrière la Suède.
b) La fragilisation des unions
La généralisation de la cohabitation pré-maritale n’a pas eu pour effet
d’infléchir la fréquence des divorces et qu’elles aient été ou non suivies d’un
mariage, les unions initiées hors mariage sont plus fragiles que les mariages
directs ; selon l’INED, parmi les premières unions commencées vers 1980, le taux
de rupture avant cinq ans est de 11 % pour les unions entamées hors mariage et de
5 % pour les autres ; avant dix ans, il était respectivement de 22 et de 12 %.
Il y a désormais 42 divorces pour 100 mariages, contre 12 pour 100 en
1970. L’indicateur de divortialité passe de 11 divorces pour 100 mariages à la fin
des années 1960 à plus de 30 dès 1985 ; il s’établit à 38 % de 1995 à 2001, puis se
monte à 42 % en 2003. Il s’agit d’un indicateur annuel qui tient compte de tous les
mariages soumis au risque. Des divorces pouvant être prononcés à des durées de
mariage élevées, il faut attendre de longues années pour pouvoir estimer la
fréquence des divorces dans les promotions de mariages. Ainsi, la fréquence de
11 divorces pour 100 mariages est en fait celle des couples mariés en 1950 ; la
fréquence de 30 % est celle des couples mariés vers 1970 ; elle devrait dépasser
38 % à partir de la promotion 1984 environ. C’est aujourd’hui autour de la
cinquième année de mariage que les risques de divorces sont les plus élevés.
Parmi les premières unions débutées vers 1980, qu’elles aient ou non pris
la forme du mariage, 8 % étaient rompues dans les cinq ans et 17 % dans les
dix ans ; pour les premières unions débutées vers 1990, la proportion de rupture
était presque double avant cinq ans (15 %) et elle est de 28 % dans les dix ans.
Lorsque l’union a commencé hors mariage, le taux de rupture est de 17 % avant
cinq ans et de 30 % avant dix ans. Aussi, Mme France Prioux, directrice d’études
à l’INED, peut-elle conclure que « l’instabilité conjugale s’accroît dans toutes les
catégories d’unions ».
La fragilisation des unions a des conséquences sur les conditions dans
lesquelles certains parents exercent leur autorité parentale : la plus grande
fréquence des séparations se traduit par une multiplication des situations où un des
parents « divorce » de son enfant et se soustrait à ses obligations parentales.
c) Le développement des familles « monoparentales » et recomposées
Le retard de l’âge de la première union et la fréquence accrue des ruptures
d’unions ont provoqué une baisse de la proportion des personnes vivant en couple,
en dessous de 55-60 ans, et une progression du nombre de personnes vivant
seules, qui représentent en 2005 14 % de la population (1), soit 3,4 millions
d’hommes et 5,0 millions de femmes. Ensemble, ils sont 1,1 million de plus qu’en
1999. Entre 35 et 50 ans, ce sont surtout les hommes qui vivent seuls, car, après
une rupture, les enfants vont le plus souvent vivre avec leur mère.PRÉSENTÉ
Par M. Jean LEONETTI, député
LE DROIT DE L’AUTORITÉ
PARENTALE CONSACRE AUJOURD’HUI L’ÉGALITÉ DE
CHAQUE PARENT DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Alors que l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers
se propose, comme son titre l’indique, d’associer plus largement le tiers à
l’exercice de l’autorité parentale, il apparaît justifié de rappeler le droit régissant
l’autorité parentale. Mais on ne saurait décrire les grandes lignes de cette
législation en faisant abstraction de la réalité de la vie familiale aujourd’hui.
Savoir s’il convient de conférer au tiers une plus grande place auprès de
l’enfant nécessite au préalable d’analyser :
— les droits et les devoirs incombant aux parents, en qualité de titulaires
de l’autorité parentale, sur un plan juridique ;
— les difficultés rencontrées par ces mêmes parents pour maintenir leur
rôle éducatif après une séparation ou un divorce, sur un plan pratique.
Après avoir tenté de faire de la famille française contemporaine la
photographie la plus fidèle possible, on s’attachera à démontrer que si le droit de
l’autorité parentale consacre l’égalité de chaque parent dans l’intérêt de l’enfant, la
séparation peut remettre en cause ce principe de coparentalité et la place que
chaque parent occupe auprès de l’enfant.
Au total, selon l’INSEE, en 2005, près de 3 millions d’enfants de moins de
25 ans (2), soit plus d’un enfant sur cinq, ne vivent pas avec leurs deux parents :
2,2 millions (15,8 %) vivent avec un parent seul, la plupart avec leur mère (13,9 %
de l’ensemble des enfants), quelques uns avec leur père (1,9 %) et 0,8 million
d’enfants (6,2 %) vivent avec l’un de leurs parents et un beau-parent. 4,3 millions
de jeunes de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale ou
recomposée (3). Il convient à cet égard de souligner la progression ininterrompue
depuis 40 ans de la proportion de mineurs vivant en famille monoparentale, qui
n’était que de 6 % en 1968, contre près de 16 % en 2005.
La notion de monoparentalité doit cependant être utilisée avec prudence.
95 % des enfants nés hors mariage sont reconnus par leur père. Les enfants élevés
seulement par leur mère sont certes plus nombreux, mais le père s’implique dans
l’éducation de l’enfant. Après séparation des parents, plus de 40 % des pères
voient leur enfant au moins une fois par mois. Les familles monoparentales
recouvrent donc des situations très différentes selon le degré d’implication du père
auprès des enfants.
(1) Ce sont majoritairement des personnes de plus de 55 ans.
(2) 2,84 millions d’enfants de moins de 25 ans exactement.
(3) Environ 1,6 million d’enfants vivent au sein d’une famille recomposée et 2,7 millions dans un foyer
monoparental.
En raison du temps qui sépare une rupture de la constitution d’un nouveau
couple et de la moins grande fréquence de la « remise » en couple des femmes séparées ayant la charge de leur enfant, les enfants vivant en famille dite
« monoparentale » sont nettement plus nombreux que ceux qui vivent avec un
parent et un beau-parent. Leur part parmi l’ensemble des enfants augmente avec
leur âge : 9 % des enfants de moins de 2 ans vivent en famille monoparentale ;
c’est le cas de 14 % des enfants entre 7 et 11 ans et de 19 % des jeunes âgés entre
18 et 24 ans qui vivent encore au domicile familial. Quel que soit l’âge, cette
proportion a progressé de deux à quatre points entre 1990 et 1999. En effet, entre
ces deux dates, le nombre de familles monoparentales comprenant au moins un
enfant de moins de 25 ans a augmenté de plus de 240 000, passant de 1,4 million à
1,64 million, alors que le nombre total de familles comprenant un ou plusieurs
enfants de moins de 25 ans s’est réduit de 300 000. Le nombre de familles
monoparentales poursuit ainsi sa progression : elles représentaient 9,4 % des
familles en 1968, 10,2 % en 1982, 15,3 % en 1990 et 18,6 % en 1999.
En 1999, 0,8 million d’enfant de moins de 18 ans vivent avec un de leur
parent et un beau-parent, chiffre qui atteint 1,1 million pour l’ensemble des jeunes
de moins de 25 ans. Parmi ces derniers, 0,5 million ne vit qu’avec ces deux
personnes, tandis que 0,6 million vit avec un demi-frère ou une demi-soeur. Si l’on
ajoute les enfants vivant avec leurs deux parents et un ou plusieurs demi-frères ou
demi-soeurs, ce sont 1,6 million de jeunes de moins de 25 ans qui vivent dans une
famille recomposée, sur les 16,3 millions de jeunes vivant au foyer parental (1). Le
tableau suivant présente la diversité des familles en 1990 et 1999 :
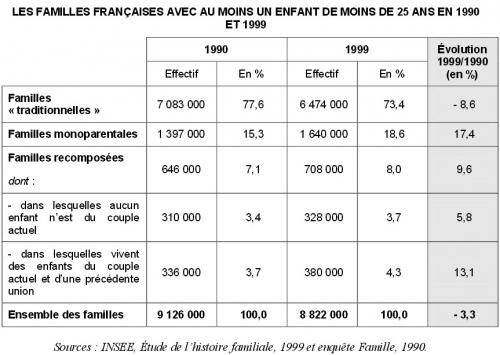
(1) En outre, 1,9 million de jeunes de moins de 25 ans ont quitté le foyer parental.
En 2005, sur les 8,7 millions de familles que compte la France, on
dénombrait 19,8 % de familles monoparentales et parmi les 16 millions d’enfants
de moins de 25 ans, 17,5 % étaient des enfants de familles monoparentales.
Par ailleurs, comme l’a constaté l’INED en juin 2009, alors « que l’on a
déjà beaucoup de difficultés à recenser les familles homoparentales, divers
chiffres circulent sur le nombre d’enfants vivant au sein de couples de même
sexe ». L’INED estime que « faute d’instruments adaptés », l’ampleur de
l’homoparentalité reste très difficile à quantifier. Si deux types d’instruments – le
recensement et les grandes enquêtes quantitatives en population générale –
permettent de dénombrer les configurations homoparentales, chacun comporte
toutefois des limites. En extrapolant des éléments issus du recensement, le
démographe Patrick Festy de l’INED parvient à une fourchette de 24.000 à 40.000
enfants résidant avec un couple de même sexe en 2005 (1).
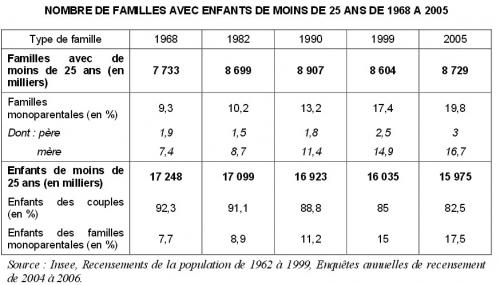
d) Des familles fondées plus tardivement et moins nombreuses
L’âge moyen au mariage a par ailleurs augmenté dans des proportions
importantes. Même s’il est de plus en plus déconnecté de celui-ci, l’âge moyen des
mères à la naissance des enfants s’est lui aussi nettement élevé. Selon l’Institut
national de la statistique et des études économiques, l’âge moyen des mères (2)
était de 27,6 ans en 1960 ; il est descendu à 26,5 ans en 1977 avant de
recommencer à augmenter pour atteindre 28 ans en 1987, 29 ans en 1995 et 29,9
ans en 2008.
En 1980, 35,85 % des mères avaient entre 15 et 24 ans à la naissance de
leur premier enfant, 56,08 % entre 25 et 34 ans et 8,07 % 35 ans et plus. En 2001, ces proportions atteignaient respectivement 17,42 %, 65,9 % et 16,68 %. L’âge
moyen des femmes à la première maternité approche désormais 28 ans (1), alors
qu’il n’excédait pas 24 ans au début des années 1970. Il a progressé de deux ans
au cours de la dernière décennie.
(1) La difficile mesure de l’homoparentalité, INED, fiche d’actualité n° 8, juin 2009.
(2) Cet âge inclut l’ensemble des naissances, quel que soit leur rang dans la famille.
Après avoir atteint son point le plus bas (1,1 %) au cours des années 1970,
la part des enfants nés d’une femme âgée de plus de 40 ans s’établit à 3,4 % en
2004, ce qui reste nettement inférieur aux 6,5 % enregistrés en 1901 mais a
récemment attiré l’attention du Haut Conseil de la population et de la famille.
Celui-ci juge préoccupant le caractère de plus en plus tardif des grossesses en
général, et des premières grossesses en particulier. Il insiste sur les risques
supplémentaires que ce retard fait courir, tant à l’enfant qu’à sa mère, les risques
étant surtout accentués pour les femmes ayant une première grossesse tardive.
Il faut néanmoins souligner que l’élévation de l’âge moyen des mères n’a
pas eu de conséquences graves sur le taux de natalité dans notre pays. L’indice
conjoncturel de fécondité français, qui s’établit à 2,02 enfants par femme en 2008,
contre 1,7 au milieu des années 1990, place notre pays aux premiers rangs de
l’Union européenne. Si l’indice conjoncturel de fécondité français est honorable,
la taille des familles se réduit néanmoins progressivement, comme en atteste le
tableau suivant :
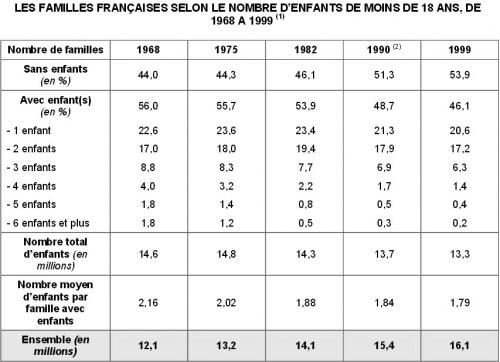
Les familles de plus de trois enfants (3) sont de plus en plus rares : elles ne
représentent plus que 4 % des familles avec enfants de moins de 18 ans en 1999,
contre 15 % en 1968.
En 2005, 8,7 millions de familles réunissaient 16 millions de jeunes de
moins de 25 ans qui cohabitent avec au moins un de leurs parents. Après avoir
baissé entre 1990 et 1999, le nombre de ces familles s’est stabilisé, de même que
le nombre d’enfants.
Les familles qui comprennent au moins un enfant de moins de 25 ans ont
en moyenne 1,8 enfant au domicile, alors qu’elles en avaient en moyenne 1,9 en
1990 et 2,3 en 1975. Cette diminution résulte de la moindre fréquence des familles
nombreuses. En 2005, 43 % des familles, soit 3,7 millions, n’ont qu’un enfant de
moins de 25 ans et 39 % en ont deux. Il convient toutefois de noter que la reprise récente de la fécondité contribue à enrayer la baisse du nombre de familles avec enfants.
(1) Ce tableau ne donne pas le nombre d’enfants par couple, mais le nombre d’enfants des familles (ceux-ci sont définis comme toute personne vivant dans le même ménage que son ou ses parent(s), quel que soit son
âge, s’il n’a pas de conjoint ou d’enfant vivant dans le ménage avec lesquels il constituerait une famille en
tant qu’adulte). Parmi ces familles, il y a des familles monoparentales.
(2) En 1990, le nombre de familles est calculé avec la nouvelle définition des enfants des familles ; par rapport à l’ancienne définition, seuls le nombre total de familles et le nombre de familles sans enfants de l’âge considéré diffèrent.
(3) Seuls sont pris en compte ici les enfants âgés entre 0 et 18 ans. Si on considère les enfants jusqu’à 24 ans, 9,2 % des familles avaient plus de 3 enfants en 1968 ; elles sont moins de 3 % en 1999.
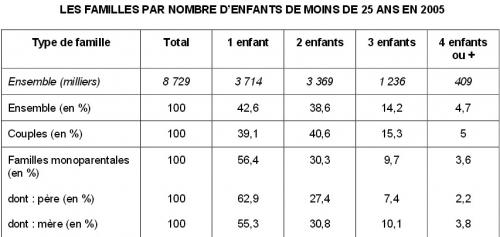
e) Les quatre cinquièmes des enfants vivent avec leurs deux parents,
mariés ou non
Comme le constatait l’INED en 1999, 73,4 % des familles avec enfants de
moins de 25 ans correspondent à la forme traditionnelle de la famille, et 78 % des
mineurs vivent avec leurs deux parents. M. Robert Rochefort, directeur général du
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, a ainsi
estimé que 85 % des enfants de moins de 15 ans vivaient avec leurs deux parents.
Il lui semble que « les facteurs de stabilité finissent par l’emporter sur les facteurs
de changement » et que « les familles résistent donc pour l’instant aux évolutions
que l’on annonce parfois en disant qu’une femme sur trois connaîtra au cours de
sa vie une logique de rupture familiale la conduisant à vivre seule, ou encore que
presque un mariage sur deux se soldera par un divorce » (1).
Si l’INED n’a pas hésité à englober dans ce qu’il appelle la forme
traditionnelle de la famille les parents non mariés, c’est que le choix du mariage
ou de l’union libre n’a pas un grand impact sur la vie de l’enfant. Certes, les
unions libres se rompent plus facilement et durent en moyenne moins longtemps
que les mariages mais la progression du divorce relativise cette différence. Si la
présomption de paternité constitue l’essence du mariage, les enfants nés hors
mariage sont néanmoins très largement et très rapidement reconnus par leurs
parents.
Dans cette étude publiée en janvier 1999 (2), l’INED estimait que plus du
tiers des enfants nés hors mariage en 1994 avaient été reconnus avant leur naissance, conjointement dans presque tous les cas. 82 % des enfants ont été
reconnus par leur père avant un mois (contre seulement un tiers des enfants nés
hors mariage en 1965 et 1970), et 92 % l’ont été in fine. 94 % des bébés reconnus
par leur père avant qu’ils n’aient un mois vivaient alors avec leurs deux parents,
alors que cette proportion n’était que de l’ordre de 80 % à la fin des années 1960
et au début des années 1970. En 1999, 89 % des enfants nés hors mariage ont été
reconnus avant d’avoir un mois, l’INED estimant que 95 % des enfants nés hors
mariage en 2002 acquerront une filiation paternelle. Environ 40 000 enfants de
plus d’un mois nés en 1999 étaient sans filiation paternelle, situation qui ne
touchait plus que 30 000 d’entre eux à l’âge d’un an. Finalement, seuls 15 000
enfants nés en 2002 devraient rester sans filiation paternelle, soit environ autant
que dans les années 1960, lorsque moins de 6 % des naissances avaient lieu hors
mariage.
(1) Naître hors mariage », Bulletin mensuel d’information de l’INED, numéro 342, janvier 1999
(2) Naître hors mariage », Bulletin mensuel d’information de l’INED, numéro 342, janvier 1999.
Le fait de naître hors mariage n’a donc plus que rarement une influence
sur la filiation des enfants. Le droit ne faisant plus de différence entre enfants
légitimes et enfants naturels, la situation de ces enfants est semblable et la
naissance hors mariage n’entraîne pas réellement de différence dans l’éducation et
la vie des enfants. Ainsi, Mme Irène Théry souligne qu’ « aujourd’hui, toutes
choses égales par ailleurs, on estime que les modes de vie familiaux, les modes de
consommation, les modes d’éducation des enfants ne présentent pas de différences
significatives selon que les parents sont ou non mariés. Au sein d’une même
parentèle, il est désormais fréquent que coexistent des familles naturelles et
légitimes, que rien ne distingue dans leur vie quotidienne. Les différences
d’appartenance sociale sont beaucoup plus significatives que les statuts
juridiques » (1).
En 2005, l’INSEE conclura pour sa part que « 81 % des moins de 18 ans
vivent avec un couple parental, leurs deux parents en général, plus rarement un
parent et un beau-parent » (2).
2. L’exercice de l’autorité parentale après le divorce
Si la famille française a connu, depuis plus de quarante ans, d’importantes
évolutions (augmentation du nombre de divorce et de familles recomposées), les
données disponibles montrent toutes que, de manière constante, l’autorité
parentale reste exercée conjointement après un divorce ou une séparation.
S’agissant du divorce, ce dernier ne remet aucunement en cause l’exercice
de l’autorité parentale qui reste commun aux deux parents dans la quasi-totalité
des divorces. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale pose
comme principe que « père et mère exercent en commun l’autorité parentale »
(article 372 du code civil). Cette règle sous-tend à la fois le droit pour l’enfant à être élevé par ses deux parents et le droit pour chacun des parents d’être impliqué
dans l’éducation de ses enfants. L’article 373-2 du code civil prévoit par ailleurs
que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de
l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des
relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre
parent ».
Ainsi, l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne doit plus être que
l’exception. En 2003, sur 100 couples divorcés, 98 continueront à exercer
conjointement l’autorité parentale. Constatant l’exercice conjoint de l’autorité
parentale dans 98 % des divorces, le juge en attribue l’exercice exclusif à l’un des
parents dans 2 % des divorces (39 mères et 3 pères). En 2006, la répartition de
l’exercice de l’autorité parentale est restée exactement la même.
(1) Irène Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie
privée, Paris, Odile Jacob - La documentation française, 1998, p. 44.
(2) Enfants des couples, enfants des familles monoparentales : des différences marquées pour les jeunes
enfants - Olivier Chardon et Fabienne Daguet, division Enquêtes et études démographiques, Insee, janvier
2009.
L’exercice de l’autorité parentale est attribué de façon légèrement
différente selon le type de procédure de divorce. L’exercice est moins
systématiquement conjoint dans les divorces pour faute que dans les divorces sur
requête conjointe. En effet, même si l’exercice en commun de l’autorité parentale
reste la règle générale dans les divorces pour faute, c’est quasiment le seul type de
divorce dans lequel il arrive que le juge confie l’exercice à un seul des parents (41
des 44 cas observés).
C’est par ailleurs lorsque l’un des parents ne comparait pas que l’autorité
parentale est le plus souvent attribuée de façon exclusive, là encore dans les divorces pour faute. La mère étant généralement seule comparante, c’est
essentiellement à elle qu’est confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
(1) Champ : les 2 306 divorces impliquant au moins un enfant mineur
(2) Lecture : 99 % des jugements de divorce contradictoires prévoient une autorité parentale conjointe et 88,9 % quand le jugement a été rendu alors qu’un seul parent était présent
3. L’exercice de l’autorité parentale après la séparation des parents
non mariés
Compte tenu de l’importance prise par les unions libres, il convient
également de s’intéresser aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à la suite
de la séparation des parents non mariés. Comme à l’occasion des divorces, les
juges aux affaires familiales peuvent être amenés à statuer sur toutes les questions
liées aux enfants : exercice de l’autorité parentale, résidence et contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans leur étude consacrée à l’exercice de l’autorité parentale après le
divorce ou la séparation des parents non mariés, Mme Laure Chaussebourg et
M. Dominique Baux ont montré que la décision du juge conserve à 93 % des
couples qui se sont séparés, un exercice conjoint de l’autorité parentale (1).
Par ailleurs, le juge confie l’exercice de l’autorité parentale de façon
exclusive à 6 % des mères. De façon encore plus exceptionnelle, l’exercice de
l’autorité parentale est attribué exclusivement au père (9 décisions sur 1 402, avec
accord des parents) ou de façon différenciée suivant les enfants (3 décisions).
En définitive, l’exercice conjoint de l’autorité parentale après la séparation
des parents non mariés est donc moins systématique que dans le cadre des
divorces (93 %, contre 98 %).
B. DONNÉES JURIDIQUES RELATIVES À L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ
PARENTALE
Introduite par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité
parentale, cette dernière a fait l’objet, au cours de ces vingt dernières années, de
plusieurs réformes qui, toutes, sont allées dans le sens d’une plus grande égalité :
entre le père et la mère mariés, à l’instar de la loi de 1970 qui a remplacé la
puissance paternelle par l’autorité parentale, mais également entre les parents
séparés, qu’ils soient ou non mariés, avec les lois n° 87-570 du 22 juillet 1987 (2)
et n° 93-22 du 8 janvier 1993 (3) qui ont séparé la résidence de l’enfant de
l’exercice de l’autorité parentale et généralisé l’exercice en commun de cette
autorité.
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale s’est
inscrite dans le droit fil de cette évolution, l’un de ses objectifs ayant été d’assurer l’égalité entre tous les enfants, quelle que soit la situation matrimoniale de leurs
parents. Elle s’est également attachée à renforcer le principe de coparentalité,
développé notamment lors de la réforme de 1993 et qui suppose l’intérêt de
l’enfant à être élevé par ses deux parents, même lorsque ceux-ci sont séparés.
(1) L’enquête a été réalisée sur un échantillon constitué des ordonnances du juge aux affaires familiales
statuant sur des demandes portant sur la résidence des enfants de parents non mariés et prononcées entre le 13 et le 24 octobre 2003. Cet échantillon est composé de 1 402 ordonnances initiales.
(2) Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale.
(3) Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
1. La substitution de l’autorité parentale à l’ancienne puissance paternelle
Pendant des siècles, la puissance paternelle a constitué le pilier de la
famille. Ainsi, à Rome, la puissance paternelle (patria potestas) est la base de la
famille patriarcale. Cette dernière est soumise à l’autorité absolue du père qui a
droit de vie et de mort sur ses enfants qui, eux, sont dépourvus de droits. Cette
conception de la famille se transforme progressivement jusqu’à prohiber
l’infanticide et la vente d’enfant (Ve siècle).
Cette conception romaine rencontrera encore un écho sous l’Ancien
Régime avec les lettres de cachet qui permettent à un père de faire enfermer
l’enfant mineur récalcitrant à son autorité. En effet, « la révérence naturelle des
enfants envers leurs parents est le lien de la légitime obéissance des sujets envers
leurs souverains » (1). L’article 371 du code civil dans sa rédaction actuelle
rappelle d’ailleurs que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et
mère ».
Pour les juristes de la Révolution, il s’agit d’ébranler et d’abolir le modèle
social de l’Ancien Régime pour privilégier la liberté individuelle. Ils établissent le
principe de la paternité civile qui donne les mêmes droits aux enfants légitimes,
naturels et adoptifs. Ils s’attaquent aussi au despotisme des pères en leur
supprimant le droit de déshériter leur progéniture et en bannissant les lettres de
cachet. Après l’abolition de la patria potestas par la loi du 28 août 1792, le père
est obligé de réunir un tribunal domestique pour faire administrer la correction
paternelle. Il ne peut plus la décider seul et sa puissance est limitée au temps de la
minorité de l’enfant.
Le code civil de 1804 reviendra sur ces avancées. Dans l’esprit de ses
rédacteurs, la famille n’existe plus que dans le mariage et l’enfant naturel reconnu
ne pourra réclamer les droits de l’enfant légitime. Le code civil amorce aussi un
retour à une autorité plus énergique, la puissance paternelle devant s’exercer dans
l’intérêt de l’enfant. En effet, ce dernier est assimilé à un incapable qu’il faut
protéger dans ses actes contre lui-même et contre autrui. Le père est ainsi présumé
faire « bon usage » de sa puissance paternelle. Les tribunaux domestiques sont
supprimés, le droit de déshériter son enfant n’étant pas pour autant rétabli. Ce
principe est garanti par l’existence de la réserve héréditaire qui garantit aux
héritiers réservataires une portion du patrimoine de leur auteur. Le père et mari
demeure seul maître dans son foyer, le principe d’une autorité parentale conjointe des père et mère, revendiqué par les révolutionnaires, restant ignoré par le code
civil.
Le XIXe siècle est nettement plus favorable à l’enfant : d’une part, les
tribunaux tentent de remédier aux abus de puissance paternelle ; d’autre part,
plusieurs lois prouvent le souci du législateur d’améliorer le sort des enfants qu’il
s’agisse de leur travail, de leur instruction et de la protection de leur intégrité
physique.
C’est la loi du 4 juin 1970 qui abolit la puissance paternelle et instaure la
notion d’autorité parentale. Par un changement significatif de vocabulaire,
l’ancienne puissance paternelle est devenue l’autorité parentale pour asseoir une
égalité entre les père et mère mais également pour modifier leur rôle éducatif. En
effet, ce qui était un pouvoir sur la personne et les biens de l’enfant est un devoir
mis à leur charge. Les rapports familiaux cessent d’être entendus en termes de
puissance ou de pouvoir souverain sur la personne de l’enfant. Ils font place à une
« autorité complexe de droits et de devoirs » (1). Les parents n’exercent plus une
domination. Désormais, le droit jusque-là discrétionnaire est transformé en une
fonction faite de droits, de devoirs et de responsabilités, destinée à satisfaire non
l’intérêt personnel ou familial de ses titulaires mais celui de son destinataire pour
le présent comme pour l’avenir. D’autres lois sont par la suite venues moderniser, par touches successives,
le droit de la famille et de l’autorité parentale. La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
réformant le droit de la filiation a créé un statut unique pour l’enfant légitime et
l’enfant naturel. Ce dernier a « en général les mêmes droits et les mêmes devoirs
que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère » (code civil,
article 334, alinéa 1 et 2, abrogé par la loi du 4 mars 2002). Trois ans plus tard, la
loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, réformant le divorce, a posé le principe de
l’attribution exclusive de la garde de l’enfant à l’un des parents, la jurisprudence
de la Cour de cassation admettant cependant la légalité de la garde conjointe après
le divorce (2).
Il faudra attendre dix ans pour que la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985
consacre l’égalité des parents dans la gestion des biens de l’enfant mineur en
disposant que « l’administration légale est exercée conjointement par le père et la
mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas,
sous le contrôle du juge soit par le père, soit par la mère ».
La loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, dite « loi Malhuret », sur l’exercice de
l’autorité parentale, est, pour sa part, venue entériner la jurisprudence précitée de
la Cour de cassation et a franchi un nouveau pas décisif en assouplissant les effets
du divorce sur le partage de l’autorité parentale. Les père et mère exercent donc
conjointement leur autorité, quel que soit le devenir du couple. Dans la famille naturelle, les parents disposent désormais de la possibilité de s’adresser au juge
des tutelles et de faire une déclaration conjointe en vue de l’exercice en commun
de l’autorité parentale, rompant ainsi avec la traditionnelle attribution de l’autorité
parentale à la mère. Avec la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, à
la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales,
l’autorité parentale conjointe est désormais posée en principe tant dans la famille
légitime désunie que dans la famille naturelle. L’accès des pères concubins à
l’autorité parentale est reconnu et la notion de coparentalité esquissée.
Il faudra toutefois attendre la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative à
l’autorité parentale pour que soit consacrée sur le plan législatif la notion de
coparentalité.
2. La reconnaissance de la coparentalité à travers la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale
La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a uniformisé les droits
et devoirs de tous les enfants dont la filiation est établie, a instauré une véritable
coparentalité en assurant le maintien du lien de l’enfant avec ses deux parents en
cas de séparation et a introduit la référence à l’intérêt de l’enfant dans la définition
de l’autorité parentale.
a) La présomption d’accord pour les actes usuels
Exerçant en commun l’autorité parentale, les parents disposent des mêmes
pouvoirs. Sur ce point, la coparentalité implique donc que les décisions soient
prises conjointement par le père et la mère. En pratique, l’application du principe
est facilitée par l’article 372-2 du code civil qui dispose qu’ « à l’égard des tiers
de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il
fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de
l’enfant ». Ce texte édicte donc une présomption d’accord pour les actes usuels,
valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de
responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. D’aucuns regrettent que la loi ne
se réfère pas à des critères permettant d’identifier les actes usuels. C’est donc au
tiers ou, en cas de conflit, au juge, qu’il reviendra de se livrer à une appréciation in
abstracto et in concreto, en fonction des circonstances particulières. L’article 372-
2 n’étant soumis à aucune condition de cohabitation des parents, il a vocation à
s’appliquer quand bien même ces derniers seraient séparés.
b) L’absence d’impact de la séparation des parents sur l’exercice de l’autorité parentale
En énonçant que « les pères et mère exercent en commun l’autorité
parentale », l’article 372 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi
du 4 mars 2002, consacre le principe de coparentalité. Celle-ci peut être définie
comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par ses deux parents. La
coparentalité impliquant que le père et la mère soient parents à égalité, sa première expression réside bien dans le principe d’exercice en commun de l’autorité
parentale. Ce principe se voit conférer la portée la plus large, puisqu’il est
indifférent à la nature de la filiation. En matière d’autorité parentale, la loi du
4 mars 2002 a ainsi été la première à délaisser la distinction entre filiation légitime
et filiation naturelle, dont l’abandon a été généralisé par l’ordonnance du 4 juillet
2005. Le principe de coparentalité concerne donc tous les enfants, dès lors qu’ils
ont une filiation paternelle et maternelle légalement établie.
Plus généralement, la séparation des parents est sans incidence sur le
principe d’exercice en commun de l’autorité parentale, comme l’énonce très
clairement l’article 373-2 du code civil, alinéa 1er : « la séparation des parents est
sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale ». Le couple
parental doit donc survivre au couple conjugal. Néanmoins, l’absence de vie
commune des parents implique que des dispositions spécifiques régissent les
modalités d’exercice de l’autorité parentale : la situation d’un mineur dont les
parents vivent ensemble est nécessairement différente de celle d’un mineur dont
les parents vivent séparément.
C’est précisément dans cette dernière hypothèse que la consécration de la
coparentalité est la plus significative, la loi du 4 mars 2002 s’employant à assurer
son effectivité à travers un certain nombre de mesures dont la plus emblématique,
mais aussi la plus controversée, est l’institution de la résidence alternée.
● La résidence alternée
La résidence alternée peut être fixée par un accord des parents ou
ordonnée par le juge (code civil, article 373-2-9). Il s’agit, incontestablement,
d’une mesure favorisant un maintien réel des liens de l’enfant avec ses deux
parents. L’accord des parents est toutefois souhaitable pour que son
fonctionnement soit réussi. En cas de désaccord ou à la demande de l’un d’eux,
l’article 373-2-9, alinéa 2, autorise le juge à prescrire une résidence alternée à titre
provisoire et donc expérimental. Au terme de celle-ci, il décide de pérenniser la
résidence alternée ou au contraire d’y renoncer.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la résidence alternée n’est
envisageable que dans la mesure où elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ainsi,
par exemple, les juges nîmois (Nîmes, 3 juillet 2002) ont-ils refusé de l’ordonner
dans les circonstances suivantes : dans le cadre de leur divorce sur requête
conjointe, des parents avaient décidé d’une résidence alternée, de trois jours en
trois jours. Le père ayant sollicité une modification pour passer d’une alternance
de huit jours en huit jours, les juges ont ordonné une enquête sociale. Celle-ci
ayant révélé une conception éducative rigide du père, allant jusqu’à des
corrections voire à la violence, ils ont fixé la résidence habituelle des enfants chez
leur mère avec un droit de visite du père. Dans ces circonstances, la résidence
alternée n’était en effet pas conforme à l’intérêt des enfants. Elle n’est donc en
aucun cas constitutive d’un droit pour les parents.
● Le droit de visite et d’hébergement
En disposant que « chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent »,
l’article 373-2 alinéa 2 du code civil pose le principe du maintien des liens de
l’enfant avec ses deux parents séparés. À défaut de résidence alternée, le respect
de ce principe implique l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit du
parent avec lequel l’enfant ne réside pas habituellement. La Cour de cassation
(Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-13/360) a précisé que « le parent qui exerce
conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et
d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur des
enfants ». Lesdits motifs doivent en outre être dûment caractérisés, ce qui est
logique dans la mesure où le refus du droit de visite contrevient au principe de
coparentalité.
● L’homologation des accords parentaux
La loi du 4 mars 2002 se montre particulièrement favorable à ces accords,
comme en témoignent deux dispositions. D’une part, l’article 373-2-11 du code
civil enjoint au juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale de prendre en considération la pratique précédemment suivie par les
parents ou les accords antérieurement conclus par eux. D’autre part, et plus
généralement, l’article 373-2-7 du code civil prévoit que « les parents peuvent
saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par
laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale ». Si les
parents ne sont pas spontanément parvenus à un accord, tout espoir d’arrêter une
position commune n’est as pour autant exclu. Le juge pourra en effet décider
d’avoir recours à la médiation familiale.
● La médiation familiale
La médiation familiale est expressément prévue à l’article 373-2-10 du
code civil, qui permet au juge d’avoir recours à ce mode alternatif de règlement
des litiges, selon la procédure décrite aux articles 131-1 et suivants du code de
procédure civile. Elle consiste pour le juge à désigner, avec l’accord des parties,
un tiers neutre et impartial afin de leur permettre de trouver une solution au conflit
qui les oppose. Là où existent des médiateurs familiaux, la mise en oeuvre de la
médiation familiale est favorisée. Sont révélatrices à cet égard les décisions de la
Cour d’appel de Paris, relevant que c’est « sauf meilleur accord des parents » que
des mesures judiciaires sont prises et exhortant plus largement les parents à avoir
« un dialogue responsable » et à rechercher, le cas échéant avec l’aide d’une
médiation familiale entreprise en dehors de toute procédure judiciaire, les
solutions les plus adaptées « dans l’exercice d’une véritable coparentalité
nécessaire à l’équilibre et au bon développement de leurs enfants » (Paris,
14 février 2008, RG n° 07/12147).
● L’obligation de notifier le déménagement
Cette obligation découle de l’article 373-2, alinéa 3, du code civil qui
impose au parent concerné, dès lors que ce déménagement implique une
modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’en informer l’autre
parent, préalablement et en temps utile. En cas de désaccord, celui-ci peut saisir le
juge pour qu’il statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Cet article a donc
clairement vocation à empêcher le parent hébergeant d’imposer à l’autre un
éloignement géographique qui rendrait impossible l’exercice par ce dernier de ce
droit de visite et d’hébergement et risquerait, par voie de conséquence, de
conduire à une rupture de ses liens avec l’enfant.
3. L’exercice de l’autorité parentale : une législation qui a pour constante un ensemble de droits et de devoirs
L’autorité parentale est expressément visée à l’article 371-1 du code civil,
qui l’a définie comme un ensemble de droits et de devoirs, dans l’intérêt de
l’enfant, confié aux père et mère, afin qu’ils protègent l’enfant dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité, qu’ils assurent son éducation et permettent son
développement personne. Temporaire, l’autorité parentale disparaît à la majorité
de l’enfant, c’est-à-dire à son dix-huitième anniversaire ou à l’occasion de son
émancipation (code civil, article 371-1, alinéa 2).
Si la loi du 4 mars 2002 n’a pas modifié cette approche globale, elle a
cherché à revaloriser l’autorité parentale en réaffirmant l’importance de la
fonction parentale, tout en veillant à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elle propose pour ce faire une nouvelle définition de l’autorité parentale, afin de
permettre aux parents d’assurer conjointement l’intérêt et l’épanouissement de
leurs enfants.
a) La notion d’autorité parentale sur la personne de l’enfant
L’enfant naît faible et démuni, si bien qu’il doit être confié à la protection
naturelle de ses parents. Cette dépendance se traduit juridiquement par l’institution
de l’autorité parentale. Selon le nouvel article 371-1, alinéa 1er, du code civil,
« l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité
l’intérêt de l’enfant ».
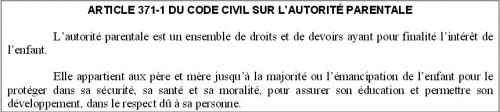
Alors que le code civil précise expressément que cette autorité parentale
appartient aux « père et mère », l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers propose, à son article 4, de remplacer l’expression « père et mère »
par celle de « parents » au premier alinéa de l’article 373-3 du code civil, consacré
à l’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation. Avant de poursuivre plus
en détail l’examen de cette notion d’autorité parentale, il est utile de s’interroger
sur la portée réelle de ce glissement sémantique.
Il apparaît d’emblée que les expressions de « père et mère » et de
« parents » sont utilisées indifféremment dans le code civil. Ainsi, alors que
l’article 371-3 de ce code dispose que « l’enfant ne peut, sans permission des père
et mère, quitter la maison familiale », l’article 373-2-11 du même code prévoit
pour sa part que « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents
avaient précédemment suivie ». Preuve ultime, s’il en était besoin, de
l’équivalence totale entre ces deux expressions : la table alphabétique du code
civil à l’occurrence « parents » renvoie directement son lecteur à « père et mère ».
C’est pourquoi, l’auteur du présent rapport juge la modification sémantique opérée
par l’avant-projet de loi inutile et propose, dans un souci de stabilité de la norme
juridique, de conserver la rédaction actuelle.
Ainsi, les « parents » ou « père et mère » sont cotitulaires de l’autorité
parentale et le resteront à égalité et à part entière pour exercer leur rôle, dans la
durée, aux côtés de leur enfant. Ils l’amèneront ensemble vers l’âge adulte en
l’aidant, en le conseillant et en l’accompagnant dans sa vie familiale, scolaire et
sociale. Attribut de la paternité et de la maternité, l’autorité parentale permet aux
parents de l’enfant de mener à bien leur tâche de protection et d’éducation. Ce sont
désormais les deux aspects de l’autorité parentale. En effet, les prérogatives
accordées aux parents ont, en premier lieu, une finalité de protection du corps et
des biens de l’enfant. L’article 371-1, alinéa 2, du code civil en décline les
différents aspects que sont sa sécurité, sa santé et sa moralité. La loi rappelle ainsi
que les parents sont ses défenseurs légaux et ses protecteurs naturels.
Ces prérogatives visent, en second lieu, à conforter les père et mère dans
leur rôle d’éducateur afin d’assurer le développement de l’enfant en leur accordant
des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Avec la recherche
de l’épanouissement de l’enfant, on est loin du pouvoir accordé aux pères dans le
code civil de 1804 qui leur permettait d’organiser la détention du mineur, avec
ordre d’arrestation délivré par le président du tribunal d’arrondissement. De cette
époque, il ne reste guère que le texte, toujours placé en tête du chapitre consacré à
l’autorité parentale pour son caractère symbolique, en vertu duquel « l’enfant, à
tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » (code civil, article 371).
b) La protection de l’enfant
Les parents sont investis d’une mission générale de protection des intérêts
du mineur, mission qui recouvre en réalité trois aspects : la sécurité, la santé, la
moralité.
● En premier lieu, afin de préserver la sécurité de leurs enfants, les
parents disposent de plusieurs prérogatives qui touchent successivement à :
— la fixation du domicile familial : ce sont les parents qui fixent la
résidence de la famille et donc de l’enfant, sachant qu’ils ont le droit d’exiger que
ce dernier habite réellement avec eux. Pour sa sécurité, il est entendu que l’enfant
ne peut pas quitter le domicile familial sans l’accord de ses parents (code civil,
article 371-3), lesquels peuvent vérifier sa correspondance et ses
communications (1), en tenant compte toutefois de son âge et des moeurs. De
même, ils peuvent organiser et contrôler ses déplacements. Par conséquent, une
autorisation familiale doit être donnée par exemple pour que l’enfant parte en
colonie de vacances, à l’occasion de chaque voyage ou court séjour effectué par
l’enfant sans ses parents, même s’il s’agit d’une simple sortie scolaire. Si les
parents ont le droit de vivre avec leurs enfants, seule une décision judiciaire peut
les en priver. Aussi l’enfant n’est-il retiré de son milieu familial qu’en cas de
nécessité, si le juge des enfants prend les mesures d’assistance éducative
adéquates.
— le consentement au mariage : en vertu de l’article 144 du code civil,
les jeunes filles et les garçons ne peuvent se marier avant dix-huit ans révolus.
Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut
accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves (le plus souvent la grossesse
de la jeune fille). Le législateur donne aux parents un droit de veto à l’occasion du
projet matrimonial de leur enfant. En effet, si les deux parents s’opposent au
mariage, la célébration doit être retardée. En cas de dissentiment entre le père et la
mère, l’accord d’un seul d’entre eux est suffisant, car ce partage vaut
consentement (code civil, article 148). L’autorisation étant discrétionnaire, il
n’existe aucun recours contre un refus.
— le choix du tuteur : le code civil attribue au parent survivant, s’il a
conservé au jour de sa mort l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle, le
droit de choisir, par testament, le tuteur de l’enfant mineur (code civil,
article 397).
— le consentement à l’adoption : assurer la sécurité de l’enfant peut
aller, dans des cas extrêmes, jusqu’à accepter de le confier à une famille adoptive.
Par le biais du consentement à l’adoption, les parents s’efforcent ainsi de veiller
aux intérêts futurs d’un enfant auquel ils ne peuvent pas prodiguer les soins
nécessaires. Cet acte étant d’une importante gravité, lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à cette adoption (code
civil, article 348, alinéa 1er). Lorsqu’elle n’est établie qu’à l’égard d’un seul, celui ci donne le consentement à l’adoption (code civil, article 348-1).
● En deuxième lieu, garants de la santé de leurs enfants, les parents ont,
aux termes de l’article 371-1, alinéa 2, du code civil, le droit et le devoir de
protéger l’enfant mineur non émancipé dans sa santé.
Il leur appartient de solliciter tout acte médical ou toute intervention
chirurgicale sur la personne de leur enfant. Ces derniers ont toute latitude pour
consulter le corps médical, choisir un traitement, demander l’admission de l’enfant
à l’hôpital ou encore consentir à une opération. Tenus de protéger l’enfant, ils sont
garants de sa santé et de son intégrité physique. Issu de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne
prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » et qu’ « aucun
acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre
et éclairé de la personne ». Le patient mineur ne pouvant, en principe, consentir
lui-même à un acte médical, en raison de son incapacité juridique, ce droit est
exercé par ses parents et constitue la contrepartie des devoirs et responsabilités qui
leur incombent et l’un des attributs de l’autorité parentale. Reprenant une
disposition du code de déontologie médicale, l’article R. 4127-42 du code de la
santé publique évoque également le consentement des parents en prévoyant qu’
« un médecin appelé à donner des soins à un mineur […] doit s’efforcer de
prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement ».
Ce même article apporte toutefois un double tempérament au rôle joué par les
parents : il prévoit, d’une part, que le consentement du mineur doit être recherché
s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision et, d’autre part, que,
si le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale risque
d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre
les soins indispensables. Deux cas de figure doivent être distingués :
— en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale : l’autorisation
donnée par un seul des parents est suffisante. En revanche, en cas de traitements
plus invasifs, voire dangereux, ou d’interventions affectant l’avenir de l’enfant, le
consentement de chaque parent est requis. Il revient alors au médecin d’apprécier
au cas par cas la nature de l’acte envisagé ;
— en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale : le parent
titulaire de l’autorité parentale prend seul les décisions relatives à la santé de
l’enfant. L’autre parent conserve toutefois le droit et le devoir de surveiller
l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants
relatifs à la vie de ce dernier (code civil, article 373-2-1, alinéa 3). À ce titre, il
doit donc être averti en cas d’intervention chirurgicale grave et devrait pouvoir
s’opposer à une opération non médicalement justifiée en saisissant le juge aux c) L’éducation de l’enfant
L’éducation est au centre de la fonction parentale, bien que son contenu
reste toutefois difficile à cerner. À la fois droit et devoir, l’éducation implique de
guider l’enfant dans la construction de sa personnalité, dans le choix de ses études
ou de son métier, en matière scolaire, religieuse, morale ou professionnelle.
L’éducation recouvre ainsi deux grandes dimensions : l’éducation scolaire et
professionnelle, d’une part, et l’éducation religieuse, d’autre part.
En premier lieu, l’éducation scolaire et professionnelle trouve une
traduction concrète dans l’obligation d’instruction. Introduite en France par la loi
Ferry du 28 mars 1882, l’obligation scolaire est désormais inscrite dans le code de
l’éducation (articles L. 131-1 à L. 131-12). Obligation de droit public, le devoir
d’éducation est imposé par l’État aux parents dans l’intérêt des mineurs.
Précisément, ils doivent veiller à instruire leurs enfants. De son côté, la convention
internationale des droits de l’enfant insiste sur la régularité de la fréquentation
scolaire, l’assiduité et le droit à un enseignement pour tous. Aux termes de
l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’obligation d’instruction s’impose aux
enfants de six à seize ans, qu’ils soient français ou étrangers.
Dans ce cadre strictement défini par la loi, il appartient aux père et mère
de choisir le type d’éducation qu’ils entendent donner à leur enfant. Ce droit est
conféré également par l’article 26, § 3, de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, qui dispose que « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le
genre d’éducation à donner leurs enfants ». La loi recommande, en ce sens, de
recourir « prioritairement » aux établissements d’enseignement (code de
l’éducation, article L. 122-1, alinéa 2), qu’ils soient publics ou privés. Il revient
aussi aux parents de choisir l’orientation générale à donner aux études de leurs
enfants (choix des langues, des filières d’enseignement…), étant précisé que
l’enfant doit désormais être associé à leurs décisions « selon son âge et son degré
de maturité » (code civil, article 371-1, alinéa 3). Pour autant, l’obligation scolaire
ne signifie pas l’obligation de scolariser l’enfant dans un établissement
d’enseignement. Les parents peuvent en effet décider de s’acquitter eux-mêmes de
cette tâche éducative, de confier l’enfant à un précepteur ou d’opter pour un
enseignement par correspondance (1). Il est enfin fait obligation aux parents de
seconder leurs enfants jusqu’au moment de leur entrée dans la vie professionnelle,
notamment par une aide pécuniaire due même lorsque l’enfant est majeur (code
civil, article 371-2, alinéa 2).
En second lieu, l’éducation religieuse est, quant à elle, une prérogative
parentale à laquelle l’enfant peut être associé. En effet, le choix de la religion (ou
la décision d’élever l’enfant dans aucune religion), le suivi de son enseignement et
de ses pratiques appartiennent aux parents. Cette liberté des parents est notamment
garantie par la convention internationale des droits de l’enfant qui affirme dans
son article 14-2° que les États parties respectent le droit et le devoir des parents
ou, le cas échéant des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci d’une
manière qui corresponde au développement de ses capacités. En principe, les père
et mère décident ensemble de l’éducation religieuse qu’ils entendent donner à leur
enfant. Si, dans l’intérêt de ce dernier, l’exercice de l’autorité parentale a été
confié à l’un des deux, celui-ci ne dispose cependant pas d’un pouvoir
discrétionnaire en la matière. L’autre parent conserve le droit et le devoir de
surveiller l’éducation de l’enfant (code civil, article 373-2-2, alinéa 3). Mais, si le
choix de la religion appartient aux parents, l’enfant peut interférer dans leur
décision, en exprimant ses propres convictions sur la question. D’ailleurs,
l’article 14-1° de la convention internationale des droits de l’enfant l’y invite,
stipulant que « les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ». En outre, l’article 371-1, alinéa 3, du code
civil impose désormais aux parents « d’associer l’enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Le plus souvent, le juge aux
affaires familiales attendra que l’intéressé atteigne l’âge de la majorité afin qu’il
puisse exercer lui-même son choix.
Ainsi, pour être baptisée selon les Témoins de Jéhovah, malgré l’opposition de l’un de ses parents, une jeune mineure a dû
attendre ses dix-huit ans (1).
d) L’obligation d’entretien
L’obligation d’entretien symbolise pour les parents la mission, non
seulement d’élever leurs enfants, mais également de les nourrir et de les entretenir
à proportion des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant. Il s’agit-là
d’une obligation légale d’ordre public à laquelle les parents de l’enfant ne peuvent
pas renoncer, sauf à démontrer qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le
faire. Cette obligation doit être resituée dans le cadre juridique de l’article 27 de la
convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que les enfants ont
droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique,
mental, spirituel, moral et social, dans les limites des possibilités financières de
leurs parents.
C’est la proximité familiale du créancier et du débiteur qui justifie l’octroi
d’aliments. L’existence du lien de parenté en ligne directe entre parents et enfants,
rend les premiers débiteurs et les seconds créanciers d’une obligation alimentaire.
Celle-ci recouvre tout ce qui englobe les besoins vitaux et va même au-delà d’un
devoir de fournir des prestations pécuniaires : elle concerne toute l’éducation de
l’enfant. Compte tenu du fait que cette obligation découle du lien de filiation, les
père et mère y sont tenus même en cas de retrait de l’exercice de l’autorité
parentale.
Ce devoir parental avait été considéré comme une conséquence de l’union
matrimoniale, dans la mesure où les rédacteurs du code civil ne concevaient les
liens de famille que dans le mariage. Cette disposition, prévue initialement pour
les enfants légitimes à l’article 203 du code civil toujours en vigueur (2), avait
néanmoins été étendue à tous les enfants en raison du principe d’égalité des
filiations, énoncé dans le code civil par le législateur en 1972 à l’article 334, alinéa
1er, aujourd’hui abrogé. La même idée est toutefois réaffirmée dans le nouvel
article 310-1 du code civil, qui prône une égalité de traitement entre tous les
enfants dans leurs rapports avec leurs père et mère. L’introduction de cette
disposition marque la volonté du législateur de placer tous les enfants sur un pied
d’égalité. La loi du 4 mars 2002 a également érigé en principe le fait que l’autorité
parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant (code civil, article 371-1) avec comme corollaire l’obligation pour les
parents de contribuer à l’entretien de l’enfant à proportion de leurs ressources
(code civil, article 371-2), donc d’assumer une obligation alimentaire.
L’obligation d’entretien des enfants mineurs et majeurs est désormais rattachée à
l’autorité parentale, sans que l’on ait à apprécier la nature de la filiation.
(1) Cass. Civ. 1ère, 11 juin 1991, D. 1991, p. 525.
(2) Aux termes duquel les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
4. Le primat de l’intérêt de l’enfant
Cette notion de l’intérêt de l’enfant occupe désormais une place centrale
dans le droit international comme dans notre droit interne. En effet, le simple
rappel des textes internationaux et nationaux permet de mettre en évidence
l’importance du critère de l’intérêt de l’enfant dans toute décision le concernant et
en particulier dans les décisions qui portent atteinte à la cellule familiale normale,
c’est-à-dire celle que constitue l’enfant vivant avec ses parents qui le protègent en
exerçant l’autorité qui leur est reconnue à cet effet.
Si ce critère est expressément utilisé dans la convention relative aux droits
de l’enfant ainsi que dans certains articles du code civil, il résulte parfois
uniquement de l’application que les juridictions font de certains textes par ailleurs
silencieux sur le sujet, tant la notion d’intérêt de l’enfant est difficile à
appréhender juridiquement.
a) Une notion difficile à appréhender juridiquement
L’ensemble des prérogatives parentales doit être exercé conformément à
l’intérêt de l’enfant, clé de voûte des réformes récentes du droit de la famille. En
effet, c’est en raison du respect qui est dû à l’enfant que le législateur confie des
missions à ses parents. Dans les textes antérieurs, les droits et devoirs de ces
derniers étaient déjà conçus dans cet esprit, mais traduisaient davantage un
pouvoir de commandement pour les parents et un devoir d’obéissance pour les
enfants.
Alors que la notion de l’intérêt de l’enfant était jusqu’à présent absente de
la définition de l’autorité parentale, référence y est faite d’emblée dans le premier
texte encadrant les prérogatives parentales (code civil, article 371-1, alinéa 1er).
Les droits et devoirs des parents ont expressément « pour finalité l’intérêt de
l’enfant ». Depuis la loi du 4 mars 2002, l’intérêt, le bien-être et l’épanouissement
de l’enfant sont les objectifs essentiels à respecter même, et surtout, s’ils divergent
de ceux des parents.
Outre une référence à l’intérêt de l’enfant dans l’article fondamental
371-1, alinéa 1er, du code civil, la loi y renvoie à de multiples reprises, qu’il
s’agisse d’entretenir des relations avec un tiers (code civil, article 371-4,
alinéa 2) ;de maintenir les relations entre frères et soeurs, ou exceptionnellement
d’organiser la séparation de la fratrie (code civil, article 371-5) ; de se prononcer
sur un changement de résidence des parents séparés (code civil, article 373-2,
alinéa 3) ; d’homologuer les accords parentaux (code civil, article 373-2-7,
alinéa 2) ou encore de confier l’enfant à un tiers (code civil, article 373-3,
alinéa 2). Afin de garantir l’intérêt de l’enfant, la société veille à la protection du
mineur, même contre ses parents, en organisant un contrôle social, en mettant en
place des mesures d’assistance éducative voire en le confiant à des tiers.
Cependant, si la philosophie générale de la loi permet de tenir compte des
sentiments exprimés par l’enfant, des résultats d’enquêtes sociales, des accords parentaux, de l’aptitude des parents à assumer leur rôle (code civil,
article 373-2-11), les textes nationaux et internationaux qui fondent l’intérêt de
l’enfant ne prévoient pas expressément les critères propres à en apprécier
précisément les contours.
« Notion magique » (1) à « contenu variable » (2), « insaisissable, fuyante,
changeante » (3), l’intérêt de l’enfant ressemble à une « boîte où chacun met ce
qu’il souhaite trouver » (4). C’est pourtant cette notion, que la loi elle-même a
renoncé à définir, qui sous-tend désormais la logique de l’exercice de l’autorité
parentale. Le Doyen Carbonnier avait à ce titre souligné le danger de l’utilisation
d’une notion si difficile à cerner : « Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser
l’arbitraire judiciaire » (5). Selon lui, l’intérêt de l’enfant est une notion à contenu
variable en raison de la diversité des interprètes de cette notion : les parents, le
juge aux affaires familiales, le législateur et, dans une moindre mesure, les grandsparents
et les enfants eux-mêmes.
Quoi qu’il en soit, dans la recherche de ce fil conducteur, le juge aux
affaires familiales est toutefois souverain. Il peut notamment décider que le choix
de la résidence alternée implique une coparentalité réelle, efficace et rejeter la
demande s’il estime qu’elle ne satisfait pas les intérêts de l’enfant, car celui-ci est
très jeune et a besoin de repères stables et sécurisants (6) ou encore parce que
l’alternance de résidence peut être déstabilisatrice pour lui (7).
b) Une notion régie par de nombreux textes internationaux et nationaux
Adoptée par acclamation par l’Assemblée générale des Nations unies le
20 novembre 1989 à New York, la convention relative aux droits de l’enfant a été
signée par tous les États du monde et ratifiée par 192 États. Seuls les États-Unis et
la Somalie, qui l’ont signée respectivement en février 1995 et en mai 2002, ne
l’ont pas ratifiée mais ont indiqué leur intention de le faire. Cette convention
solennise l’accession de l’enfant au statut de sujet de droits.
La France fait partie du groupe des premiers signataires : elle a signé la
convention le 26 janvier 1990 et celle-ci est entrée en vigueur pour la France le
6 septembre 1990. Cette convention, qui peut à juste titre être qualifiée
d’universelle, s’applique donc en France depuis près de quinze ans. La mise en
oeuvre des principes qu’elle énonce s’est progressivement traduite par une
évolution de la législation française sur de nombreux points.
(1) Jean Carbonnier, note sous cour d’appel de Paris, 30 avril 1959, D. 1960.673, spéc. P. 675.
(2) Jean Carbonnier, « Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille », in C. Perelman et
R. Vander Elst, Les notions à contenu variables en droit, Bruxelles, 1984, p. 99, spéc. p. 104.
(3) O. Bourguignon, J.-L. Rallu, I. Théry, Du divorce et des enfants, INED, 1985, p. 34, par I. Théry.
(4) F. Dekeuwer-Défossez, « réflexion sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille », revue
trimestrielle de droit civil, 1995, p. 249, spéc. p. 265.
(5) Jean Carbonnier, note sous cour d’appel de Paris, 30 avril 1959, D. 1960.673, spéc. P. 675.
(6) CA Douai, 18 avril 2002, Juris-Data, n° 179312.
(7) CA Nîmes, 3 juillet 2002, AJ famille 2002, 339.
De son côté, le Conseil de l’Europe a mené à son terme, le 25 janvier
1996, une procédure complémentaire à celle qui a conduit à l’adoption de la
convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il a élaboré une
convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, entrée en vigueur le
1er juillet 2000 et signée par vingt-quatre États membres du Conseil et quatre États
non européens. Si la France a signé cette convention, elle ne l’a pas ratifiée.
● La convention internationale relative aux droits de l’enfant
Avant même la convention de New York, les droits de l’enfant avaient été
l’objet de la Déclaration de Genève, adoptée par la Société des Nations en 1924,
puis d’une déclaration approuvée à l’unanimité par l’Assemblée générale des
Nations unies, le 20 septembre 1959. Mais le caractère déclaratoire de ces textes
les privait de tout caractère contraignant. La convention de New York ne se
contente pas de conférer un caractère contraignant au socle minimal de principes
définis en 1959 qui insistait simplement sur la nécessité d’accorder à l’enfant une
protection spécifique : elle pose le principe selon lequel l’enfant est une personne
et, à ce titre, lui reconnaît des droits civils, sociaux et culturels, mais aussi des
libertés publiques directement inspirées des droits de l’homme.
Malgré les compromis qui ont dû être concédés pour permettre la
ratification de la convention par le plus grand nombre d’Etats(1), les droits qu’elle
énonce contribuent à transformer le statut de l’enfant, qui n’est plus seulement
objet de protection mais devient avant tout sujet de droits.
Les principes généraux sont la non-discrimination dans la mise en oeuvre
des droits de l’enfant (article 2), la prise en compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant (article 3), le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) et la
prise en considération des opinions de l’enfant sur toute question l’intéressant
(article 12).
Une série de libertés et de droits civils sont reconnus à l’enfant : droit à un
nom et à une nationalité (article 7) ; droit à la préservation de cette identité
(article 8) ; liberté d’expression (article 13) ; liberté de pensée, de conscience et de
religion (article 14) ; liberté d’association et de réunion pacifique (article 15) ;
protection de la vie privée (article 16) ; accès à l’information (article 17).
La convention détaille aussi les droits sociaux et culturels des enfants :
outre le droit à la survie et au développement (article 6) et à un niveau de vie
permettant ceux-ci (article 27), elle affirme les droits à la santé, aux services
médicaux (article 24) et à la sécurité sociale (article 26) et reconnaît aux enfants
handicapés le droit à une « vie pleine et décente » (article 23). Les enfants ont
droit à l’éducation, y compris à la formation et à l’orientation. Ils on droit aussi au
repos, aux loisirs et à des activités récréatives et culturelles (article 31), tandis qu’ils ont le droit d’être protégés, notamment, contre l’exploitation économique
(article 32), l’usage des drogues (article 33) et l’exploitation sexuelle (article 34).
L’article 30 reconnaît des droits spécifiques aux enfants appartenant à une
minorité ethnique, religieuse ou linguistique, la France, qui ne reconnaît pas les
minorités ayant émis une réserve sur cette disposition.
De nombreuses stipulations ont trait aux conditions de vie de l’enfant dans
sa famille ou, en cas de nécessité, hors de celle-ci : l’article 5 reconnaît aux
parents de l’enfant, ou à sa famille élargie, « la responsabilité, le droit et le
devoir » de l’orienter et de le conseiller dans l’exercice de ses droits; l’article 9
charge les États de veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents, sauf
si « cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant » ; dans ce
cas, l’enfant garde le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si ce droit est contraire à son intérêt supérieur.
Afin de préserver ces droits, la « réunification familiale » (ou « regroupement
familial ») doit être considérée avec bienveillance par les États (article 10) et ces
derniers doivent lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants
(article 11). L’enfant a le droit d’être protégé par l’État contre toute forme de
violence (article 19), ce qui peut nécessiter qu’il soit privé de son milieu familial
et lui donne alors droit à une protection et une aide spéciales de l’État (article 20).
Celles-ci peuvent prendre la forme d’un placement, lequel devra faire l’objet d’un
examen périodique (article 25). L’article 21 exige des États qu’ils s’assurent que «
l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale » en cas d’adoption,
l’adoption à l’étranger ne devant être envisagée qu’en l’absence de solution dans
le pays d’origine.
Enfin, la convention prévoit des mesures spéciales de protection de
l’enfance, pour les enfants réfugiés (article 22), pour ceux qui ont été victimes de
maltraitances (article 39), pour ceux qui sont suspectés ou convaincus d’infraction
à la loi pénale (article 40).
Le caractère contraignant du texte se traduit par la mise en place d’un
dispositif de contrôle de son application. Est institué, par l’article 43 de la
convention, un Comité des droits de l’enfant, composé de dix experts élus pour
quatre ans par les États. Il est chargé d’examiner les rapports relatifs aux mesures
d’application des stipulations de la convention, prises par chaque État signataire.
Ces rapports sont remis deux ans après l’entrée en vigueur de la convention, puis
tous les cinq ans. Sur cette base, un dialogue doit s’engager entre le comité et
chaque État.
Inspiré d’un modèle de contrôle largement répandu dans le système des
Nations unies en matière de droits de l’homme, cet organe n’est pas une
juridiction et ne dispose pas de pouvoirs coercitifs. Si d’aucuns regrettent que le
comité ne puisse ni s’autosaisir ni mener des enquêtes, il ne faut pas sous-estimer
sa capacité d’influence, laquelle s’est avérée particulièrement importante en
France.
● Les progrès de la France dans le respect des droits de l’enfant
Le Comité des droits de l’enfant a examiné, en juin 2004, le rapport de la
France sur l’application de la convention. Il a salué l’adoption ces dernières
années de nombreux textes législatifs et réglementaires qui confortent les droits
des enfants :
— la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 autorisant l’approbation de la
convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, et celle n° 2001-111 du 6 février
2001 relative à l’adoption internationale ;
— les dispositions de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des
mineurs ;
— la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation
compensatoire en matière de divorce, qui a élargi la possibilité de révision des
rentes allouées en cas de changement important de la situation financière des
époux ;
— la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint
survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit
successoral, qui supprime les discriminations successorales subies par les enfants
naturels adultérins ;
— la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
— la loi n°° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale qui
vise notamment à garantir le droit de l’enfant à entretenir des relations avec ses
deux parents ;
— la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection
de l’enfance qui renforce le droit de l’enfant à être protégé.
Le comité s’est également réjoui de la création d’un Observatoire national
de l’enfance en danger, par la loi du 2 janvier 2004 précitée.
Depuis lors, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et la loi
n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption ont été promulguées
et l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a été
publiée. Ce dernier texte supprime les notions d’enfant légitime et d’enfant naturel
et les dernières différences qui subsistaient entre eux, notamment en matière
d’actions relatives à la filiation. Il parachève sur ce point la mise en conformité du
droit français à la convention. La loi n° 2002-93 du 23 janvier 2002 relative à
l’accès à leurs origines personnelles par les personnes adoptées et pupilles de
l’État constitue elle aussi un progrès.
Interrogée en 2006 par la mission d’information sur la famille et les droits
de l’enfant (1) sur les mesures adoptées récemment qui marquent un progrès pour
le respect des droits de l’enfant, Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, avait
cité : « la pénalisation des clients de prostituées âgées de 15 à 18 ans ; le très bon
texte sur l’autorité parentale, qui consacre la coparentalité et permet de mieux
tenir compte de la parole de l’enfant ; le décret qui autorise l’accès des intéressés
à leur dossier dans le cas d’une procédure d’assistance éducative ; la loi de
janvier 2002 sur le renforcement des droits de l’usager des institutions médicosociales
; la distinction entre assistantes familiales et assistantes maternelles et
l’amélioration de leur statut ; l’indispensable relèvement de l’âge légal du
mariage pour les filles. La proposition de loi sur l’adoption que l’Assemblée a
adoptée en première lecture va aussi dans le bon sens. En se penchant avec
attention sur la situation des adolescents, la conférence de la famille de 2004 a,
d’autre part, témoigné d’une prise de conscience des difficultés de cette tranche
d’âge. La protection des professionnels qui font des signalements et la création,
dans la loi Perben, d’établissements pour les mineurs qui doivent être incarcérés
sont d’autres mesures qui me semblent aller dans une bonne direction ». Ainsi
Mme Claire Brisset avait-t-elle estimé que « globalement, la France n’a pas à
rougir de la manière dont elle traite ses enfants et respecte leurs droits. Toutefois,
certains textes sont imparfaits et certaines pratiques pêchent ».
Le dernier rapport du Comité des droits de l’enfant sur l’application par la
France de la convention de New York, en date du 22 juin 2009 met à l’actif de
notre pays toutes les réformes législatives intervenues depuis 2004 et portant
principalement sur la réforme du divorce, la création de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité, la réforme de l’adoption, de la filiation,
du droit des successions, de la protection juridique des mineurs et de l’enfance. Le
comité s’est également félicité que la France soit devenue partie aux conventions
internationales suivantes : la convention pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, le 23 septembre 2008 et le deuxième protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, le 2 octobre 2007. Les sujets de préoccupation du
comité se focalisent pour l’essentiel sur les problèmes soulevés pour les enfants
par le droit de la santé, l’éducation, la maltraitance, le handicap et le droit des
étrangers et ne concernent pas la problématique à l’origine du présent rapport. Le
Comité des droits de l’enfant invite la France à adopter des règles de procédure
concrètes prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et souhaite d’une
manière générale que les actions des pouvoirs publics évaluent celles-ci à l’aune
du critère de l’intérêt de l’enfant.
(1) Rapport d’information (n° 2832) fait au nom de la mission d’information sur la famille et les droits des enfants, présidée par M. Patrick Bloche et rapportée par Mme Valérie Pécresse, députés.
c) L’application de la convention de New York par le juge français :
une illustration de l’imprécision qui entoure l’intérêt de l’enfant
En vertu de l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, les
normes conventionnelles, une fois ratifiées, font parties intégrantes du dispositif
normatif national et ont, sous réserve de leur application par l’autre partie, une
autorité supérieure à celle des lois. Mais cela n’implique pas qu’un particulier
puisse se prévaloir des droits proclamés devant un magistrat. Les juridictions
subordonnent en effet la mise en oeuvre des dispositions du traité à la
reconnaissance ou non de leur caractère d’application directe.
Or les juges français ont adopté une position prudente et contrastée, sur
l’applicabilité des stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant,
preuve du caractère imprécis et insaisissable de ce que recouvre réellement la
notion de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, la Cour de cassation s’est généralement, et
jusqu’à une date très récente, refusée à considérer que les articles de la convention
ou certains d’entre eux, puissent être considérés comme d’application directe par
les tribunaux de l’ordre judiciaire, et ce, malgré les décisions contraires rendues
par le Conseil d’État. En définitive, suivant l’ordre de juridiction considéré, les
stipulations de la convention sont d’application directe ou non, ce qui conduit à
faire de l’intérêt de l’enfant une norme juridique à géométrie variable dont le
contenu peut différer suivant qu’on l’invoque devant la juridiction administrative
ou la juridiction judiciaire. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que si une
norme internationale n’est pas d’applicabilité directe et n’ouvre donc aucun droit
aux particuliers, elle peut toujours servir de référence à un contrôle de
compatibilité d’une norme inférieure, avec la difficulté que plus la norme
supérieure est générale, moins il y a de probabilité que le contrôle de compatibilité
aboutisse à la censure de la norme inférieure.
● Les réticences de la Cour de cassation, en partie levées depuis mai 2005
Peu après l’entrée en vigueur de la convention, les juridictions du fond de
l’ordre judiciaire, en de nombreuses affaires, ont considéré ses articles 2, 3-1, 7-1,
12, 20, 21 et 26 comme d’applicabilité directe. Mais, le 10 mars 1993, par le
célèbre arrêt Lejeune (1), la Cour de cassation a mis un terme à cette pratique.
En effet, de l’article 4 de la convention (2) qui stipule que les dispositions
de celle-ci ne créent d’obligations qu’à la charge des États parties, elle a déduit
que ces dispositions ne pouvaient être invoquées directement devant les
juridictions nationales. Dans un système moniste, en effet, l’applicabilité directe
des conventions et leur invocabilité par les particuliers peuvent être tempérées
dans deux cas : soit le traité ne contient que des recommandations ou des
obligations qui s’adressent aux États et à eux seuls, soit les règles posées ne sont
pas applicables, du fait de leur formulation trop imprécise ou conditionnelle, et faute de mesures permettant d’en définir les modalités d’application. La Cour de
cassation considère donc que la convention de New York relève de la première
hypothèse. Il est vrai que de nombreuses stipulations de la convention
commencent par des expressions comme « Les États parties s’engagent à ... »,
« Les États parties veillent à... ».
Le rejet de principe de l’applicabilité directe de la convention par la Cour
de cassation apparaît aujourd’hui de moins en moins assuré. Ainsi, la chambre
criminelle a reconnu à plusieurs reprises l’applicabilité directe de l’article 40 de la
convention. Si elle a récusé celle de l’article 37 en 1997, elle a admis la
recevabilité de recours fondés sur les articles 2 et 16 en 1999 et l’article 3-1 en
2001, même si c’était, dans les deux cas, pour rejeter le moyen.
Interrogé en 2006 par la mission d’information sur la famille et les droits
de l’enfant (1), M. Jean-Pierre Rosenczveig avait très vivement critiqué la position
de la Cour de cassation : « La question de la portée de la convention des droits de
l’enfant a une importance capitale. Les arrêts de la Cour de cassation ont un très
fort impact à l’étranger. Aussi son arrêt selon lequel la convention n’est pas
d’application directe et ne donne donc pas aux enfants des droits directs a-t-il été
ressenti comme un coup de poignard ».
Une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation s’est néanmoins
dessinée : à l’occasion de deux affaires jugées le 18 mai 2005, la première
chambre civile a reconnu pour la première fois l’applicabilité directe de
l’article 3-1 (primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant) et, dans l’un de ces deux
arrêts, de l’article 12 (droit d’être entendu dans toute affaire le concernant). Un
arrêt du 14 juin 2005 a confirmé l’applicabilité directe de l’article 3-1. Dans l’une
des deux affaires jugées le 18 mai 2005, la Cour de cassation a même relevé
d’office le moyen, non invoqué par les parties, tiré de la violation des articles 3-1
et 12. Il semble donc que la Cour s’engage sur la voie d’une application
« sélective » de la convention, inspirée de la pratique suivie, depuis l’entrée en
vigueur de celle-ci, par le Conseil d’État.
(1) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 mars 1993, Lejeune.
(2) L’article 4 prévoit en effet que « les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures (...) nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus par la présente convention ».
● La position dès l’origine plus ouverte du Conseil d’État
Dès l’entrée en vigueur de la convention, le Conseil d’État a en effet
cherché à distinguer, en son sein, les dispositions d’application directe de celles
qui ne le sont pas. Ainsi, dans sa décision Préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet
1994, il a considéré que les stipulations de l’article 9 ne créaient d’obligations
qu’entre les États, sans ouvrir de droits aux intéressés. Il a de même estimé que ne
produisaient pas d’effets directs pour les particuliers, notamment, les dispositions
des articles 24-1, 26-1 et 27-1 de la convention (arrêt GISTI du 23 avril 1997).
En revanche, l’article 16 relatif à la vie privée des mineurs peut être
invoqué directement par les particuliers, tout comme les dispositions de l’article 8
(préservation de l’identité de l’enfant), celles de l’article 3-1 (primauté de l’intérêt
supérieur de l’enfant) et de l’article 37 (conditions d’emprisonnement d’un
mineur). La jurisprudence du Conseil d’État n’est cependant pas totalement fixée
en ce qui concerne l’applicabilité directe des articles 4 (1) et 16 (2).
Même si une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation est
incontestable, des divergences de jurisprudence, difficiles à résoudre, demeurent
donc. Si les deux ordres de juridiction semblent désormais unanimes sur la
reconnaissance du droit d’un enfant à invoquer l’article 3-1 de la convention, la
Cour de cassation a reconnu l’applicabilité directe de son article 12 (3), laquelle a
été rejetée par le Conseil d’État.
Cette incursion dans la jurisprudence sur la portée de la convention de
New York montre que, si l’intérêt de l’enfant constitue un critère juridique
reconnu par les deux plus hautes juridictions françaises, son caractère opérationnel
varie suivant l’ordre de juridiction considéré, ce qui affaiblit sa force juridique.
(1) Rapport d’information (n° 2832) fait au nom de la mission d’information sur la famille et les droits des enfants, présidée par M. Patrick Bloche et rapportée par Mme Valérie Pécresse, députés.
C. L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE À L’ÉPREUVE DES FAITS
1. L’enfant victime des conflits entre adultes
L’exercice conjoint de l’autorité parentale se relève parfois difficilement
de la séparation du couple à laquelle il est censé survivre, l’enfant étant trop
souvent la première victime des conflits entre adultes.
En effet, le cabinet du juge est le lieu quotidien où sont recueillies les
difficultés pratiques d’application du principe de coparentalité, dès lors que les
parents n’ont pas pris toute la mesure de sa portée, soit par simple ignorance ou
négligence, soit par intention délibérée de nuire à l’autre parent. Instrumentalisé,
l’enfant est alors à la fois la victime et l’otage de ses parents.
Afin que le parent qui n’a pas obtenu la résidence de l’enfant ne se sente ni
défavorisé, ni dépossédé, les juges aux affaires familiales considèrent, de manière
unanime, que le maximum d’actes doit relever de l’autorité parentale conjointe ou
de la coparentalité. Si tel n’est pas le cas, ce parent, pour asseoir son autorité, sera
tenté de prendre unilatéralement un certain nombre de décisions (tenues vestimentaires, coupes de cheveux, piercing, activités extrascolaires, etc.), sans
aucune concertation avec l’autre parent. De tels passages en force ne manquent
pas en retour de raviver les querelles autour de la personne de l’enfant, qui semble
en définitive bien démuni au milieu de ces conflits entre adultes.
Les pédopsychiatres ont montré que les enfants pris en otage dans de
multiples actes de la vie quotidienne par chacun de leurs parents, finissent sur le
plan psychologique par faire taire leur souffrance : c’est le syndrome clinique de
l’enfant sacrifié ou parfait. M. Maurice Berger, pédopsychiatre, a ainsi remarqué
que « même lors des résidences alternées consensuelles, ces enfants cachent leur
souffrance […]. Ils montrent qu’ils se sacrifient en acceptant ce mode de vie pour
ne pas décevoir leur père et mère, et se présentent comme parfaits, adaptés aux
désirs de leurs parents, avec même une bonne réussite scolaire ».
S’agissant des difficultés pratiques et concrètes d’exercice conjoint de
l’autorité parentale, force est toutefois de constater qu’elles ne fondent que très
rarement la saisine du juge.
Alors que l’ancien article 372-1-1 du code civil prévoyait explicitement la
possibilité pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit
pris position sur un différend relatif à l’exercice de l’autorité parentale,
l’article 373-2-8 issu de la loi du 4 mars 2002, beaucoup plus général dans sa
rédaction, dispose seulement que le juge peut être saisi pour « statuer sur les
modalités d’exercice de l’autorité parentale ».
(1) Article 4 : « Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres
qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente convention. Dans le cas des
droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont
ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale ».
(2) Article 16 : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
(3) Article 12 : « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la
possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale. »
Comme le souligne M. Laurent Gebler, vice-président du tribunal de
grande instance de Libourne, juge aux affaires familiales, « en cinq années
d’exercice en qualité de juge aux affaires familiales, le nombre de saisines
fondées exclusivement sur un différend en matière d’exercice conjoint de
l’autorité parentale se compte sur les doigts d’une main » (1). En revanche, la
question surgit très fréquemment à l’occasion des débats en matière de
contribution à l’entretien des enfants, de fixation de résidence ou des droits de
visite, l’un des parents se plaignant d’être tenu à l’écart des décisions prises par
l’autre concernant l’enfant.
2. Les principaux domaines de conflits autour de la personne de l’enfant
Deux domaines, parmi tant d’autres, semblent toutefois cristalliser
davantage les conflits au moment du divorce ou de la séparation : les actes
administratifs et l’école.
a) Les documents administratifs En la matière, c’est la question récurrente devant le juge aux affaires
familiales de l’établissement des pièces d’identité, autorisations de sortie du territoire et passeports pour les enfants qui fait le plus souvent débat.
En général, l’enjeu réside dans la crainte par l’un des parents de voir l’autre partir à l’étranger avec l’enfant, soit qu’il redoute le non-retour de celui-ci à l’issue du séjour, soit que les conditions d’accueil de l’enfant lui paraissent contestables. C’est notamment le cas lorsque l’un des parents est de nationalité ou d’origine étrangère, hors de l’Union européenne. L’autre parent entend alors pouvoir contrôler les déplacements de l’enfant à l’étranger, en rendant son accord
préalable nécessaire.
En l’état actuel de notre législation, un mineur ne peut quitter le territoire français sans y avoir été au préalable autorisé par l’un ou l’autre des codétenteurs de l’exercice de l’autorité parentale.
S’il voyage seul, il doit être muni d’un passeport personnel. Il n’est plus possible désormais d’inscrire un enfant sur le passeport de ses parents. Toutefois les anciens passeports parentaux portant inscription de l’enfant demeurent valables (sauf pour les États-Unis) jusqu’à leur expiration (cinq ans). Dès lors que l’enfant dispose d’un passeport personnel, ce document est suffisant pour lui permettre de
sortir du territoire national. L’établissement de ce passeport personnel n’exige pas le consentement des deux parents, chacun étant réputé agir avec l’accord de l’autre. Cependant, si un parent apprend que l’autre a l’intention de faire établir un passeport pour l’enfant et qu’il s’y oppose, il a la possibilité d’en aviser la préfecture (service de délivrance des passeports). Son opposition justifiée produira
ses effets pendant un an et fera obstacle à la délivrance du passeport pour l’enfant.
Ce délai permettra, le cas échéant, au parent opposant d’obtenir une décision judiciaire sur le fondement de l’article 373-2-6 du code civil (infra).
Si le passeport de l’enfant a déjà été délivré, cette dernière démarche, exercée au besoin en référé, est le seul moyen de subordonner le départ de l’enfant hors du territoire au consentement de ses deux parents.
Dans la plupart des États européens, l’enfant peut aussi voyager sans passeport, muni de sa carte d’identité. Mais s’il voyage ainsi sans être accompagné d’un détenteur de l’autorité parentale pouvant justifier de cette qualité, il doit être en outre muni d’une autorisation de sortie du territoire. Celle-ci est délivrée par la mairie du domicile du parent cotitulaire de l’autorité parentale qui entend délivrer cette autorisation, l’accord de l’autre parent étant là encore présumé, en l’état actuel du droit. Si ce dernier a préalablement manifesté son opposition auprès de la préfecture, cette opposition fera obstacle à la délivrance d’une autorisation de sortie du territoire.
Il peut sembler surprenant que la délivrance d’un passeport ou d’une
autorisation de sortie du territoire – acte dont la portée peut être significative au regard de ses conséquences possibles – ne soit pas soumise à la double autorisation des détenteurs de l’autorité parentale, au même titre qu’une
autorisation aux fins d’opération chirurgicale ou de changement d’orientation
scolaire.
Elle peut toutefois s’expliquer par la nécessité de ne pas entraver
abusivement et durablement la circulation d’un mineur à l’étranger, notamment
lorsqu’il part en vacances avec l’un de ses parents. Permettre à l’un des parents de
disposer d’un droit de veto sur l’organisation des déplacements de l’enfant avec
l’autre pourrait être considéré comme abusif, et ce d’autant plus qu’il s’agit
souvent d’un moyen pour l’enfant de conserver des liens avec une partie de sa
famille élargie résidant à l’étranger. Si l’avant-projet de loi, qui prévoit de
soumettre désormais la délivrance du passeport ou de la carte d’identité au double
accord parental, se concrétise (encadré ci-après), il appartiendra alors au juge aux
affaires familiales de statuer le cas échéant sur le caractère abusif ou non du refus
de l’autre parent.
La crainte d’un non-retour de l’enfant doit être relativisée eu égard aux
procédures de plus en plus efficaces issues de la convention de La Haye du
25 octobre 1980, du Règlement communautaire dit « Bruxelles II bis » et des
accords bilatéraux, notamment entre la France et les pays du Maghreb. Elle doit
cependant être mise en balance avec les inconvénients sérieux que pourrait générer
l’exigence systématique d’un double consentement parental.
Certaines procédures conservatoires ou d’urgence peuvent néanmoins
permettre de prévenir un risque avéré d’enlèvement de l’enfant par l’un des
parents.
C’est ainsi qu’une opposition à sortie du territoire peut être déposée en
préfecture ou auprès d’un commissariat en cas d’urgence. Valable sept jours, cette
opposition mentionne l’identité de l’enfant et du parent susceptible de quitter le
territoire avec lui, ainsi que les postes frontières susceptibles d’être concernés.
Leurs noms sont immédiatement portés au fichier automatisé des personnes
recherchées auquel ont accès les services de police et de gendarmerie. Cette
mesure d’opposition en urgence est automatiquement radiée du fichier à expiration
du délai de 7 jours si elle n’est pas transformée en opposition provisoire ou
permanente.
La mesure d’opposition conservatoire permet à l’un des parents exerçant
l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son
enfant, en attendant de pouvoir justifier de ses droits ou d’obtenir une décision de
justice interdisant le départ de l’enfant sans son consentement.
La mesure d’opposition conservatoire pourra alors être transformée en mesure d’opposition
de longue durée valable un an, et renouvelable d’année en année.
Cette opposition de longue durée intervient dès lors que le droit à opposition est établi ou encore reconnu en application de la loi (autorité parentale exclusive) ou d’une décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 373-2-6 du code civil.
Si les juges aux affaires familiales sont régulièrement saisis de requêtes en
ce sens, l’accueil favorable de cette sollicitation est, pour les motifs précédemment
énoncés, loin d’être systématique. Il ne saurait en tout cas s’agir d’une clause de
style sur les jugements de divorce ou sur les décisions statuant sur l’exercice de
l’autorité parentale chaque fois que l’un des parents est d’origine ou de nationalité
étrangère. Le parent qui sollicite cette mesure exceptionnelle doit justifier d’un
risque sérieux d’enlèvement de l’enfant par l’autre parent (précédentes tentatives,
menaces réitérées, absence de toute attache de l’autre parent sur le territoire français…).
Cependant, la portée de cette décision doit être relativisée.
D’une part, la stricte interprétation de l’article 373-2-6 du code civil, qui
permet au juge d’ordonner l’inscription de l’interdiction de sortie de l’enfant du
territoire français sur le passeport des parents, est susceptible de vider le texte de
sa substance dès lors que, comme on l’a rappelé, les enfants mineurs doivent
désormais disposer d’un passeport personnel et ne pourront plus être inscrits sur
ceux de leurs parents à l’expiration de leur période de validité de cinq ans. En
conséquence, et sous réserve de la modification prévue de la loi ou d’une
interprétation large du texte actuel par les magistrats, le dispositif de l’article 373-
2-6 dans sa rédaction actuelle ne s’applique pas aux nouveaux passeports délivrés
aux enfants à titre personnel. L’inscription ne peut donc être ordonnée que sur les
passeports parentaux incluant les enfants et en cours de validité.
D’autre part, elle ne permet l’inscription que sur le passeport d’un enfant
ou d’un parent français. Si l’autre parent est de nationalité étrangère et que
l’enfant possède la double nationalité, il pourra toujours se faire délivrer un
passeport pour lui-même et pour son enfant auprès de son pays d’origine. Les
autorités françaises ne peuvent empêcher un consulat ou une ambassade d’un autre
pays de délivrer un titre de voyage à un ressortissant français qui possède
également la nationalité de ce pays. Il appartient alors au parent opposant de
demander - décision judiciaire à l’appui - de ne pas délivrer de passeport à l’enfant
et de ne pas permettre son inscription sur celui de l’autre parent.
En prévoyant que les interdictions provisoires ou durables de sortie du
territoire seront désormais inscrites systématiquement sur le fichier des personnes
recherchées et non plus sur les passeports, l’avant-projet de loi simplifie le
dispositif. Cependant, il ne faut pas dissimuler que la perméabilité des frontières,
notamment au sein de l’espace Schengen, ne permet pas toujours d’exercer un
contrôle suffisant aux frontières. Les documents remis au parent opposant
mentionnent d’ailleurs systématiquement l’absence de garantie d’une exécution
certaine des oppositions à sortie du territoire.
b) L’école
● Aspects pratiques
Lors des différentes auditions, certains juges aux affaires familiales ont
souligné qu’ils étaient régulièrement saisis par l’un des parents à la suite du départ
brutal, avec l’enfant du couple, de l’autre parent. Il ressort en effet des débats avec
les praticiens et les associations que le parent peut, sans difficulté aucune, en plein
milieu d’année scolaire, obtenir de l’école primaire d’origine un certificat de
radiation et réinscrire l’enfant dans l’école de son nouveau domicile.
Certes, l’article 372-2 du code civil dispose qu’« à l’égard des tiers de
bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il
fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de
l’enfant ». Faut-il considérer que l’inscription dans un établissement scolaire ou la
radiation de l’enfant constitue un acte usuel de l’autorité parentale, c’est-à-dire,
pour reprendre la définition la plus couramment admise, un acte qui ne fait pas
rupture avec le passé et qui n’engage pas l’avenir ?
La réponse ne peut être binaire : il ne saurait, par exemple, être fait
obstacle à la décision d’un parent muni d’une décision fixant chez lui la résidence
principale de l’enfant de l’inscrire à l’école publique de son domicile, s’agissant
en l’espèce d’un acte usuel de l’autorité parentale.
En revanche, dès lors qu’aucune décision de justice ne régit la situation de
l’enfant, la prudence devrait être de mise, surtout s’agissant d’un couple non
marié. Il suffirait alors à l’école de solliciter de façon systématique la production
d’un acte de naissance de l’enfant : si celui-ci a été reconnu par ses deux parents
dans l’année de sa naissance, l’autorité parentale est nécessairement conjointe.
Dans les faits, l’école d’origine, saisie par un seul des parents d’une
demande de certificat de radiation en plein milieu d’année scolaire, sachant que
l’enfant a un autre parent codétenteur de l’autorité parentale, ne peut faire
l’économie de vérifier le consentement de ce dernier à une telle démarche non
usuelle. De même, l’école d’accueil est légalement tenue pour le moins de
demander au parent de produire une décision judiciaire fixant à son domicile la
résidence de l’enfant et, à défaut, de solliciter l’accord de l’autre parent qui
apparaît sur l’acte de naissance.
En négligeant de procéder à des vérifications minimales et en se réfugiant
à tort derrière les dispositions de l’article 372-2 du code civil, l’Éducation
nationale peut de facto faciliter un déplacement illicite d’enfant.
D’autres décisions en matière de scolarité doivent être considérées comme
non usuelles, exigeant de ce fait l’accord des deux parents. Il s’agit notamment des
décisions prises en matière d’orientation scolaire, dès lors qu’elles impliquent une
modification dans la trajectoire scolaire de l’enfant : redoublement, « saut » de classe, orientation vers une voie professionnelle ou spécialisée, vers un établissement à caractère confessionnel…
En revanche, les autres décisions et autorisations afférentes à la vie scolaire doivent pouvoir être prises par un seul parent agissant pour le compte des deux, dès lors bien entendu qu’aucun indice ne laisse à penser qu’un désaccord pourrait exister : inscription à la cantine, voyage scolaire, autorisation d’absence, inscription à l’aide aux devoirs ou au soutien scolaire…
Quant à l’envoi des bulletins scolaires, convocations aux réunions avec les
enseignants, élection des parents d’élèves, les directives de l’Éducation nationale
prescrivent régulièrement aux établissements de les adresser systématiquement
aux deux parents lorsque ceux-ci vivent séparément, sans qu’il y ait lieu d’exiger
que les informations destinées au parent non « gardien » soient subordonnées à
une demande expresse de sa part ou doivent transiter par le parent chez lequel
l’enfant réside habituellement. Les doléances exprimées par les parents dans le
cabinet du juge aux affaires familiales démontrent que cette prescription pourtant
simple à mettre en oeuvre est loin d’être respectée par tous les établissements
scolaires.
● Aspects juridiques
L’éducation nationale offre un bon terrain d’accomplissements d’actes
usuels pour lesquels le consentement d’un seul parent suffit, l’accord de l’autre
devant être présumé par les responsables administratifs. Il n’y a pas lieu dès lors,
pour un directeur d’école, de surseoir à une décision pouvant être prise au vu de
l’autorisation donnée par un seul parent, telle qu’une autorisation de sortie ou de
voyage scolaire, le choix d’une telle option ou d’une langue vivante.
Seuls des choix importants pour l’avenir de l’enfant justifie que
l’administration scolaire exige l’accord exprès des deux parents exerçant
ensemble l’autorité parentale. Ce pourrait être le cas d’une décision d’orientation
vers une filière dont les débouchés seraient notoirement réduits.
En l’état actuel de la jurisprudence, chacun des parents peut obtenir, au
titre des actes usuels bénéficiant de la présomption d’accord de l’autre parent,
l’inscription ou la radiation d’une école de leur enfant mineur, « sans qu’il soit
besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il
justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet
enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute
l’accord réputé acquis de l’autre parent » (Cour administrative d’appel de Paris,
2 octobre 2007, Giammarco X).
De la même façon, les justifications des absences scolaires, ponctuelles
et brèves, de l’enfant, même présentées seulement par oral par la mère ou le père
sont des actes usuels qui n’ont pas à être portés à la connaissance de l’autre parent
par l’administration (Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2007,
P. c/Recteur de l’académie de Créteil). Le carnet de correspondance de l’enfant, qui est toujours dans son cartable et qui est conservé par la famille à la fin de l’année scolaire, n’a pas à être transmis par l’école à la demande de l’autre parent (même jugement).
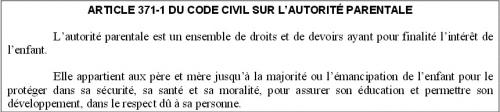
Cette présomption simple, est susceptible de preuve contraire. Si l’autre époux estime que son conjoint a abusé du pouvoir donné par l’article 372-2 du code civil pour passer un acte sans son assentiment, il lui appartient de saisir le juge. Cela pourrait également constituer une faute justifiant une demande en
divorce ou la mise en jeu de la responsabilité civile. Le tiers intervenu dans un acte usuel à la demande d’un seul époux ne peut se voir inquiéter juridiquement, dès lors qu’il était de bonne foi, c’est-à-dire dès lors qu’il n’avait pas connaissance d’une dissension relative à cet acte. Celui qui aurait eu connaissance de l’opposition du conjoint ne pourrait être considéré de bonne foi. Il appartient à
l’époux qui attaque le tiers de prouver sa mauvaise foi.
Au titre des actes parentaux importants, nécessitant systématiquement l’accord des deux parents, il faut ranger la décision d’orientation de l’élève ou encore, dans certaines conditions, la décision d’inscription (cf. supra). Si les parents séparés ne sont pas d’accord sur le mode de scolarisation de leur enfant et si l’administration en est informée (Cour administrative d’appel de Paris,
2 octobre 2007, Giammarco X), seul le juge pour enfant peut résoudre le différend
et non l’administration scolaire (Cour administrative d’appel de Nancy, 27 janvier
2005, ministre de l’Éducation nationale c/Y.). Il appartient dans tous les cas au
parent de permettre « à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis
de l’autre parent » (Conseil d’État, 8 février 1999, Dupin)
Dans les rapports avec les tiers, on peut craindre que ceux-ci ne demandent, en dépit de la présomption de pouvoir de chaque parent pour les actes usuels concernant la personne de l’enfant (art. 372-2 du code civil), le consentement exprès du père et de la mère, chaque fois que par leur intervention,
l’enfant courra un risque ou que de leur intervention des conséquences pécuniaires importantes pourront découler.
c) Le choix de la résidence
Au moment du divorce ou de la séparation des parents, le choix de la résidence des enfants tend le plus souvent à cristalliser les tensions, voire les conflits, qui peuvent apparaître lors de ruptures familiales. En effet, la question de la résidence des enfants après la séparation de leurs parents est une question majeure, qui concentre sur elle l’attention de tous les protagonistes. Or, seul l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel doivent se conformer les parents et que le juge a la charge de mettre en avant, lorsque les parents ne peuvent trouver un accord, doit orienter la résolution de cette question.
● La résidence des enfants mineurs à la suite du divorce de leurs parents
Alors que l’article 373-2-9 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, dispose que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux »,
l’étude précitée de Mme Laurence Chaussebourg et M. Dominique Baux
(octobre 2007) constate que dans près de 77 % des divorces, les enfants mineurs
résident avec leur mère, cette décision du juge aux affaires familiales correspondant aux demandes formulées in fine par les parents. Dans environ 14 % des divorces, les enfants résident alternativement chez leur père et leur mère, alors que les pères ne sont que 7 % à avoir leur(s) enfant(s) à demeure (1). En effet, les mineurs les plus âgés vivent plus fréquemment chez leur père : environ 11 % des enfants âgés entre 14 et 18 ans résident chez lui et seulement 3 % des enfants de moins de 2 ans. La résidence alternée atteint quant à elle son maximum aux âges de 7 à 8 ans : 13 % des enfants de ces âges bénéficient de ce mode de résidence.
De surcroît, dans seulement 2 % des divorces avec enfant, un désaccord sur la résidence persiste à l’issue de la procédure de divorce, chacun des parents souhaitant obtenir la résidence de l’enfant chez lui. Le juge fixe alors la résidence chez la mère dans 65 % des cas et chez le père dans 26 % des cas. Les 9 % restant se partagent équitablement entre une résidence en alternance et une fratrie séparée
entre le père et la mère.
● La résidence des enfants mineurs à la suite de la séparation de leurs parents non mariés
L’étude précitée de Mme Laurence Chaussebourg et M. Dominique Baux a permis de mettre en évidence que, dans 92 % des décisions concernant des enfants de parents non mariés, la résidence de l’enfant sera fixée chez un seul de ses parents : 84 % chez la mère et 8 % chez le père. La résidence alternée ne
concerne en définitive que 6 % des enfants, contre 14 % en cas de divorce.
À l’instar de ce qui peut être observé en cas de divorce, le mode de résidence des enfants mineurs varie en fonction de leur âge. Ainsi, plus l’enfant est âgé, plus il résidera chez son père au détriment d’une résidence chez sa mère (plus de 15 % à partir de 13 ans). La résidence alternée prend le relais de la
résidence chez la mère de 5 à 7 ans (2) avant d’être dépassée par la résidence chez le père. Si cette dernière prend nettement le pas sur la résidence alternée à partir de 10 ans, celle-ci, en cas de divorce, domine sur la résidence chez le père jusqu’à l’âge de 14 ans.
(1) Il s’agit pour la plupart d’adolescents.
(2) En effet, la résidence alternée culmine à plus de 10 % pour les enfant âgés de 5 à 7 ans.
Contre seulement 2 % des couples qui divorcent, 6 % des couples non
mariés qui se séparent restent en désaccord sur la résidence des enfants à l’issue de
la procédure. La résidence est alors fixée un peu moins souvent chez la mère qu’en
cas d’accord (69 %) et plus souvent chez le père (17 %) ou en alternance (10 %).
● La résidence alternée : rendre la coparentalité effective au détriment de l’intérêt de l’enfant ?
Afin de donner sa pleine effectivité au principe de coparentalité, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a prévu la possibilité
pour le juge aux affaires familiales d’opter pour une résidence alternée en cas de séparation ou de divorce des parents. Ainsi, aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
En cas de désaccord ou à la demande de l’un d’eux, le deuxième alinéa de ce même article autorise le juge à prescrire une résidence alternée à titre provisoire et donc expérimental, dont il détermine lui-même la durée. Au terme de celle-ci, il décide de pérenniser la résidence alternée ou au contraire d’y renoncer. L’accord des parents est toutefois souhaitable pour que le fonctionnement d’une résidence
alternée soit réussi.
Décriée par les uns, surtout pour les très jeunes enfants(1), défendue par d’autres, la résidence alternée permet à l’enfant de vivre au quotidien tantôt chez son père, tantôt chez sa mère. Reste à savoir si elle est toujours le gage d’une coparentalité réellement partagée entre les parents dans l’intérêt de l’enfant.
Si elle favorise incontestablement un maintien réel des liens de l’enfant avec ses deux parents, elle n’en présente pas moins de sérieuse limites. Tout d’abord, elle a des implications financières relativement importantes, si bien que, dans les faits, elle est davantage adaptée à des ménages aisés. En effet, l’enfant partageant sa vie entre le domicile du père et le domicile de la mère, il lui est
impossible de « déménager » l’ensemble de ses affaires chaque semaine, ce qui contraint de facto les parents à tout prévoir en double, à disposer d’un espace pour l’enfant et à prendre en charge ses frais de déplacement. Ainsi, un couple aux revenus modestes qui viendrait à se séparer, quand bien même il souhaiterait la mise en place d’une résidence alternée, ne pourrait probablement pas l’assumer, faute de moyens suffisants.
Cependant, les critiques les plus fortes adressées à la résidence alternée viennent des pédopsychiatres. Dans une étude intitulée « La résidence alternée chez les enfants de moins de six ans (2) : une situation à hauts risques psychiques », plusieurs praticiens (3) ont souligné l’existence « d’une véritable
(1) M. Berger et J. Phelip, Le livre noir de la garde alternée, Dunod, 2006.
(2) D’après les chiffres du ministère de la Justice, en 2005, 11 % des enfants de moins de six ans étaient en
résidence alternée après une séparation parentale.
(3) Maurice Berger, Albert Ciconne, Nicole Guedeney, Hana Rottman, La résidence alternée chez les enfants
de moins de six ans : une situation à hauts risques psychiques, revue Devenir, 2004.
pathologie psychique due à la résidence alternée, avec l’apparition d’un ou des
symptômes suivants » : sentiment d’insécurité avec apparition d’angoisses,
d’abandon qui n’existaient pas auparavant, ces enfants ne supportant plus
l’éloignement de leur mère et demandant à être en permanence avec elle ;
sentiment dépressif avec un regard vide pendant plusieurs heures ; troubles du
sommeil ; eczéma ; agressivité, en particulier à l’égard de la mère considérée
comme responsable de la séparation ; perte de confiance envers les adultes, en
particulier envers le père qui peut être rejeté, etc. L’étude poursuit en ajoutant que
« ces troubles peuvent s’installer de manière durable à l’adolescence et se
retrouver à l’âge adulte sous la forme d’angoisse et de dépression chroniques ».
M. Pierre Levy-Soussan, pédopsychiatre partage ce point de vue sur la
résidence alternée. Lors de son audition(1), il a rappelé la nécessité pour l’enfant, à
son plus jeune âge, d’avoir des repères stables, asymétriques, complémentaires et
répétitifs, soulignant au passage que « l’enfant peut tout à fait reconstruire une vie
où la place de l’un et de l’autre est asymétrique, où il verra moins l’un de ses
parents. Il s’agit d’une réalité qui est parfois plus bénéfique que préjudiciable à
l’enfant ». En effet, la résidence alternée repose sur une vision purement
sociologique des liens familiaux, vision elle-même porteuse de risques
psychologiques pour l’enfant. Non contente de déstabiliser les repères affectifs,
sociaux et scolaires par l’alternance, la garde alternée devient le plus souvent le
nouveau lieu d’affrontement du couple, où l’enfant, objet et non sujet, est
instrumentalisé par les adultes.
3. L’effectivité des liens parentaux après la séparation
Après le divorce ou la séparation, nombre de couples peinent à maintenir
concrètement les relations avec leur enfant. Pour que la coparentalité puisse
effectivement perdurer, il faut que les parents soient bien préparés et qu’ils
ajustent ensemble leurs pratiques dans de multiples domaines (éducation,
résidence, etc.). Pour cela, toute solution convenue entre eux est la bienvenue et le
législateur privilégie les accords parentaux soumis ensuite au juge pour
homologation (code civil, article 373-2-7).
Les parents en difficultés sont dirigés vers la médiation familiale (code
civil, article 373-2-10) qu’il convient de développer beaucoup plus largement(2). Il
revient également au juge de s’assurer de la bonne compréhension par le père et la
mère de la mesure instaurée. Ainsi, tenir compte de l’allaitement de l’enfant par sa
mère peut amener le magistrat à fixer progressivement le droit de visite et
(1) Audition du jeudi 7 mai 2009.
(2) Le Gouvernement est favorable au développement de la médiation familiale en cas de séparations
familiales : réponse du 10 mars 2009 de la garde des Sceaux à la question n° 30004 de Denis Jacquat du 2
septembre 2008, JO du 10 mars 2009. D’autres arguments ont été développés par la Commission
Guinchard et le Médiateur de la République.
d’hébergement du père. Il faut alors que ce dernier comprenne ces motivations et
soit averti que la décision est temporaire(1).
Les parents doivent surtout comprendre que leur rôle éducatif n’est pas
affecté par la rupture. La notion de coparentalité est pourtant mal connue – en
particulier par les couples non mariés – et donc mal appréhendée, le parent non
cohabitant n’ayant pas toujours conscience de la plénitude des prérogatives qui lui
sont octroyées. Le nombre de divorces (sans compter les séparations de couples
hors mariage) est évalué à 139 147.
Parmi les enfants de parents divorcés,: 25 % voient leur père une fois par semaine,
22 % ne le voient que quatre fois par an,
18 % jamais et
17 % sont élevés par leur père.
Ces chiffres montrent que les enfants demeurent encore majoritairement auprès de leur mère, si bien que ce sont les pères qui ont des difficultés à maintenir le lien et à exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère.
Lorsque le père a une nouvelle compagne, les relations avec ses enfants du premier lit risque d’être encore plus distanciées. Il est pourtant essentiel que le parent qui ne vit pas avec l’enfant comprenne qu’il existe d’autres manières de maintenir les liens avec l’enfant. Ainsi, sans côtoyer l’enfant tous les jours, il peut favoriser des échanges avec lui grâce aux technologies modernes de
communication (courriels et autres Webcam, appels téléphoniques, etc.), qui sont
autant de moyens efficaces pour donner un sens à la coparentalité.
En tout état de cause, ces échanges permettent le dialogue et l’expression de sentiments, contribuant ainsi à diminuer les tensions et à assurer la continuité des rapports éducatifs.
(1) TGI Dax, 26 avril 2006 qui invite les parents à intenter une nouvelle procédure lorsque l’enfant sera âgé de deux ans.
Fin de la Première Partie.
DEUXIÈME PARTIE
L’INTÉRÊT DE L’ENFANT PEUT
NÉCESSITER L’INTERVENTION DES TIERS DANS
L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
A. MIEUX DÉFINIR LE RÉGIME DES ACTES USUELS ET IMPORTANTS DE
L’AUTORITÉ PARENTALE
La première ambition de l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers est de conférer aux actes usuels et importants une définition législative, qui serait seule susceptible de délimiter l’intervention du tiers dans la vie courante.
En effet, alors que la distinction entre ces deux types d’actes repose actuellement sur une construction jurisprudentielle évolutive, s’efforçant de s’adapter à la diversité des familles, le texte se propose de clarifier le régime des actes usuels et importants pour donner une base légale claire aux actes qui peuvent être effectués par un tiers autorisé par l’un des parents et ceux qui ne peuvent être
effectués que par les parents.
1. La distinction entre actes usuels et importants repose sur une jurisprudence s’adaptant à la diversité des familles .
En énonçant que les « père et mère exercent en commun l’autorité parentale », l’article 372 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, consacre la coparentalité. Celle-ci peut être définie comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par ses deux parents. La coparentalité
impliquant que le père et la mère soient parents à égalité, sa première expression réside bien dans le principe d’exercice en commun de l’autorité parentale.
Exerçant en commun l’autorité parentale, les parents disposent des mêmes pouvoirs. Sur ce point, la coparentalité implique donc que les décisions soient prises conjointement par le père et la mère. En pratique, l’application de ce principe est facilitée par l’article 372-2 du code civil, qui régit la distinction entre actes usuels et non usuels.
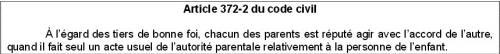
a) Les actes usuels bénéficient de la présomption d’accord entre les parents
L’article 372-2 du code civil édicte une présomption d’accord pour les actes usuels, valant dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers de bonne foi. Il s’agit là d’une présomption légale qui a pour but de réduire les inconvénients liés à la conception
collégiale de l’autorité parentale : il ne faut pas en effet que cette conception serve de prétexte pour exiger à tout propos une double signature.
Or, le code civil ne définit pas les critères permettant d’identifier les actes usuels. Par conséquent, c’est à la jurisprudence d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, s’il s’agit d’un acte usuel ou bien d’un acte grave, inhabituel, pour lequel une décision collégiale s’impose « dans les grandes circonstances qui
intéressent corps ou âme la personne de l’enfant (un engagement religieux, une intervention chirurgicale grave, une orientation professionnelle, etc.) » (1). Il est vrai que la communauté de résidence va conférer nécessairement à son bénéficiaire une prépondérance de fait dans l’autorité parentale au jour le jour, qui ne peut être contre balancée que par un devoir d’information.
b) Les actes importants nécessitent l’accord des deux parents
Si les actes usuels profitent de la présomption d’accord entre les parents, l’accomplissement des actes importants par un parent nécessite que celui-ci sollicite obligatoirement l’accord de l’autre parent.
On considère généralement qu’un acte est important ou non usuel, s’il rompt avec le passé ou s’il engage l’avenir de l’enfant. Ainsi, tout choix inhabituel ou important dans la vie de l’enfant requiert l’accord systématique des deux parents. La responsabilité du parent qui a pris une décision sans l’accord de l’autre ainsi que celle du tiers qui l’a exécutée, pourrait être engagée en cas de
non-respect de cette exigence.
c) La jurisprudence a défini une ligne de partage relativement stable entre les actes usuels et les actes importants
Sont considérés par la jurisprudence comme des actes usuels bénéficiant de la présomption d’accord de l’autre parent :
— une intervention chirurgicale bénigne et médicalement nécessaire pratiquée à la demande d’un parent seul ainsi que les soins médicaux de routine (vaccinations obligatoires, blessures légères, soins dentaires, maladies infantiles bénignes) de manière générale (TGI de Paris, 6 novembre 1973) ;
— une demande d’inscription, par un seul parent, de ses enfants mineurs sur son passeport (CE, 8 février 1999 ; CE, 4 décembre. 2002) ainsi que la demande de documents administratifs (carte d’identité…) pour l’enfant de manière générale ;
— la réinscription de l’enfant un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation (CA Paris, 2 octobre 2007),
ceci sans préjudice pour l’acteur du devoir d’informer l’autre parent (cf. supra).
Sont en revanche considérés comme des actes importants exigeant l’accord explicite des deux parents :
— la circoncision rituelle pratiquée dans les religions juive et musulmane, dans la mesure où elle constitue un signe d’appartenance religieuse ainsi que le choix d’une religion pour l’enfant de manière générale (CA Paris, 29 septembre 2000 ; CA Rennes, 4 avril 2005) ; — la primo inscription dans un établissement scolaire, dans la mesure où il y a un vrai choix à faire entre école publique, privée ou religieuse ; l’inscription dans un établissement scolaire où les enseignements sont dispensés dans une autre langue que le parent non-résident ne maîtrise pas (Cass. Civ. 1ère, 8 novembre 2005) ; l’inscription dans une école religieuse alors que l’enseignement dispensé à l’enfant était auparavant public et laïc, dans une école avec des méthodes pédagogiques particulières ou peu communes, l’inscription à un cours de catéchisme (CA Toulouse, 7 novembre 2006) ;
— les interventions chirurgicales nécessitant l’hospitalisation prolongée de l’enfant, sauf cas d’urgence où le médecin peut prendre le risque d’agir avec l’accord d’un seul parent (TGI de Paris, 6 novembre 1973) ;
— le choix du nom d’usage de l’enfant (Cass. Civ. 1re, 3 mars 2009) ;
— le consentement à un prélèvement d’organes sur le mineur décédé (article L. 1232-2 du code de la santé publique) ou l’acceptation d’une offre transactionnelle en réparation d’un préjudice moral issu d’une transfusion sanguine contaminée (CA Paris, 12 octobre 2004) ;
— l’autorisation d’une recherche biomédicale sur le mineur (articles L. 1122-1 et L. 1122-2 du code de la santé publique) ;
— le consentement à l’adoption d’un mineur (3e alinéa de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles) ;
— les décisions d’adoption (article 348-3 du code civil), d’abandon (article 350 du code civil) et d’émancipation (article 477 du code civil) ;
— l’ouverture d’un compte bancaire et la conclusion d’une assurance-vie sur la tête du mineur (alinéa 1 de l’article L. 132-4 du code des assurances) ;
— la demande de perte de la nationalité française (CE, 26 juillet 2006) ;
— la participation de l’enfant à une émission télévisée sur les parents divorcés sans le consentement de sa mère ou à des photographies même si son père est célèbre (CA Versailles, 11 septembre 2003) ;
— la décision du regroupement familial destinée à faire venir sur le territoire français un enfant mineur (article R. 421-5-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTES USUELS ET DES ACTES IMPORTANTS
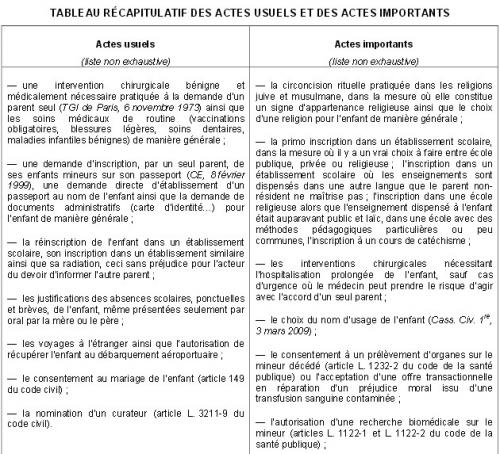
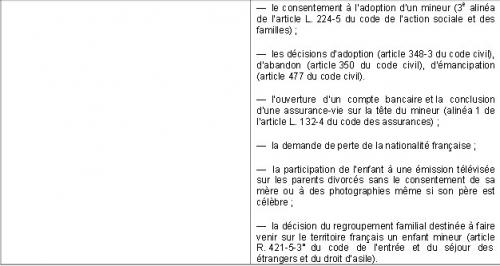
Actes usuels
(liste non exhaustive)
— une intervention chirurgicale bénigne et médicalement nécessaire pratiquée à la demande d’un
parent seul (TGI de Paris, 6 novembre 1973) ainsi que les soins médicaux de routine (vaccinations
obligatoires, blessures légères, soins dentaires, maladies infantiles bénignes) de manière générale ;
— une demande d’inscription, par un seul parent, de ses enfants mineurs sur son passeport (CE, 8 février
1999), une demande directe d’établissement d’un passeport au nom de l’enfant ainsi que la demande de
documents administratifs (carte d’identité…) pour l’enfant de manière générale ;
— la réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation, ceci sans préjudice pour l’acteur du devoir d’informer l’autre parent ;
— les justifications des absences scolaires, ponctuelles et brèves, de l’enfant, même présentées seulement par oral par la mère ou le père ;
— les voyages à l’étranger ainsi que l’autorisation de récupérer l’enfant au débarquement aéroportuaire ;
— le consentement au mariage de l’enfant (article 149 du code civil) ;
— la nomination d’un curateur (article L. 3211-9 du code civil).
Actes importants
(liste non exhaustive)
— la circoncision rituelle pratiquée dans les religions juive et musulmane, dans la mesure où elle constitue un signe d’appartenance religieuse ainsi que le choix d’une religion pour l’enfant de manière générale ;
— la primo inscription dans un établissement scolaire, dans la mesure où il y a un vrai choix à faire entre école publique, privée ou religieuse ; l’inscription dans un établissement scolaire où les enseignements sont dispensés dans une autre langue que le parent non résident ne maîtrise pas ; l’inscription dans une école religieuse alors que l’enseignement dispensé à l’enfant était auparavant public et laïc, dans une école avec des méthodes pédagogiques particulières ou peu communes, l’inscription à un cours de catéchisme ;
— les interventions chirurgicales nécessitant l’hospitalisation prolongée de l’enfant, sauf cas d’urgence où le médecin peut prendre le risque d’agir avec l’accord d’un seul parent ;
— le choix du nom d’usage de l’enfant (Cass. Civ. 1re, 3 mars 2009) ;
— le consentement à un prélèvement d’organes sur le mineur décédé (article L. 1232-2 du code de la santé publique) ou l’acceptation d’une offre transactionnelle en réparation d’un préjudice moral issu d’une transfusion sanguine contaminée ;
— l’autorisation d’une recherche biomédicale sur le mineur (articles L. 1122-1 et L. 1122-2 du code de la
santé publique) ;
— le consentement à l’adoption d’un mineur (3e alinéa de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles) ;
— les décisions d’adoption (article 348-3 du code civil), d’abandon (article 350 du code civil), d’émancipation (article 477 du code civil).
— l’ouverture d’un compte bancaire et la conclusion d’une assurance-vie sur la tête du mineur (alinéa 1 de l’article L. 132-4 du code des assurances) ;
— la demande de perte de la nationalité française ;
— la participation de l’enfant à une émission télévisée sur les parents divorcés sans le consentement de sa mère ou à des photographies même si son père est célèbre ;
— la décision du regroupement familial destinée à faire venir sur le territoire français un enfant mineur (article R. 421-5-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
2. L’avant-projet de loi propose une définition, qui vient consacrer la jurisprudence, sans toutefois résoudre toutes les difficultés
Dans son souci de mieux encadrer le régime des actes usuels et importants et ainsi de circonscrire l’intervention du tiers, l’avant-projet de loi s’attache à clarifier les notions d’actes usuels et importants. En effet, avant de permettre à chaque parent d’associer un tiers à l’éducation de son enfant, ce texte entend définir exactement l’étendue des prérogatives qu’il peut exercer seul et délimiter
les actes qui ne peuvent être exercés que d’un commun accord, notamment en matière de délivrance d’un titre d’identité ou de transport ainsi que de sortie du territoire.
a) La clarification de la notion d’actes usuels et importants
L’avant-projet de loi envisage de clarifier les contours de la notion d’actes
usuels et d’actes importants :
— grâce à la définition législative des actes importants et de leur régime juridique, en insérant à l’article 372-2 du code civil un second et nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’accord des parents est requis pour effectuer les actes importants de l’autorité parentale. Sont réputés tels les actes qui engagent l’avenir de l’enfant ou qui touchent à ses droits fondamentaux » ;
— grâce à la possibilité offerte au juge aux affaires familiales d’autoriser, dans certaines conditions, le tiers à qui est confié l’enfant d’accomplir un acte important de l’autorité parentale, en insérant un nouvel alinéa à l’article 373-4 du
code civil : « Le tiers à qui est confié l’enfant peut saisir le juge afin d’être
autorisé à effectuer un acte important de l’autorité parentale, lorsque l’intérêt de
l’enfant le justifie et, notamment, en cas de refus abusif ou injustifié, de négligence
des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou d’impossibilité pour eux
d’effectuer un tel acte, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la
nécessité de cette mesure » ; exemple Tiers digne de Confiance en jugement Juge des Enfants,pour établir une carte d'identité pour des voyages scolaires,et de passeport pour voyager dans un autre pays,pour raison de Mariage familiale.
— grâce à la consécration législative offerte à chacun des parents d’autoriser un tiers à accomplir un acte usuel de l’autorité parentale, en complétant le régime des actuels usuels, régi par le premier alinéa de l’article 372-2 du code civil : « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale ou qu’il autorise un tiers à effectuer un tel acte ».
Cependant, cette clarification du régime juridique des actes usuels et importants ne pourra a priori pas résoudre l’ensemble des difficultés et, lors des auditions réalisées par l’auteur du présent rapport, plusieurs reproches ont été adressés à l’encontre de cette tentative de définition.
● Une définition seulement négative des actes usuels
En premier lieu, si les actes importants sont bien identifiés, à l’inverse les actes usuels de l’autorité parentale sont définis de manière seulement négative : sont des actes usuels – bénéficiant de la présomption d’accord entre les parents– ceux qui « n’engagent pas l’avenir de l’enfant, notamment quant à sa santé ou à son éducation, ou qui ne touchent pas à ses droits fondamentaux ». M. Philippe
Malaurie, professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), considère quant à lui que « cette définition ne sert à rien » (1) : aucune difficulté particulière n’est observée dans la pratique, dans la mesure où les parents peuvent donner mandat à toute personne au quotidien pour les actes usuels.
M. Laurent Gebler, juge aux affaires familiales et vice-président du Tribunal de grande instance de Libourne, conteste la logique d’une définition seulement négative des actes usuels. En effet, l’article premier de l’avant-projet de loi prévoit d’inscrire dans la loi la possibilité pour chacun des parents d’autoriser un tiers à accomplir un acte usuel de l’autorité parentale. Or, cet aménagement du
principe de la « co-décision » en matière d’actes usuels n’est guère une nouveauté sur le plan juridique. En l’état actuel du droit, chacun des parents peut autoriser un tiers à accomplir un acte usuel concernant la personne de l’enfant, autorisation qui peut être tacite et n’a dès lors pas besoin d’être exprimée. Ainsi, lorsqu’un parent confie son enfant à un tiers, il donne à celui-ci un mandat tacite pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, « la logique voudrait que ce soit cette notion d’acte usuel qui soit précisée, puisqu’elle induit un tempérament au principe de décision conjointe, et non, comme le propose l’avant-projet de loi, la notion d’acte important ».
● Une définition seulement négative des actes usuels
En premier lieu, si les actes importants sont bien identifiés, à l’inverse les actes usuels de l’autorité parentale sont définis de manière seulement négative : sont des actes usuels – bénéficiant de la présomption d’accord entre les parents –
ceux qui « n’engagent pas l’avenir de l’enfant, notamment quant à sa santé ou à son éducation, ou qui ne touchent pas à ses droits fondamentaux ». M. Philippe Malaurie, professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), considère quant à lui que « cette définition ne sert à rien » (1) : aucune difficulté particulière n’est observée dans la pratique, dans la mesure où les parents peuvent donner
mandat à toute personne au quotidien pour les actes usuels.
M. Laurent Gebler, juge aux affaires familiales et vice-président du Tribunal de grande instance de Libourne, conteste la logique d’une définition seulement négative des actes usuels. En effet, l’article premier de l’avant-projet de loi prévoit d’inscrire dans la loi la possibilité pour chacun des parents d’autoriser un tiers à accomplir un acte usuel de l’autorité parentale. Or, cet aménagement du
principe de la « co-décision » en matière d’actes usuels n’est guère une nouveauté sur le plan juridique. En l’état actuel du droit, chacun des parents peut autoriser un tiers à accomplir un acte usuel concernant la personne de l’enfant, autorisation qui peut être tacite et n’a dès lors pas besoin d’être exprimée. Ainsi, lorsqu’un parent confie son enfant à un tiers, il donne à celui-ci un mandat tacite pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, « la logique voudrait que ce soit cette notion d’acte usuel qui soit précisée, puisqu’elle induit un tempérament au principe de décision conjointe, et non, comme le propose l’avant-projet de loi, la notion d’acte important ».
● Une clarification susceptible de remettre en cause la coparentalité
En deuxième lieu, certains juges aux affaires familiales rencontrés pour rédiger ce rapport se sont montrés très réservés sur cette tentative de définition des actes usuels et importants. En effet, selon eux, le risque n’est pas négligeable que les parents estiment que l’accord de chacun d’eux n’est pas requis pour les actes usuels, alors que les juges aux affaires familiales militent pour faire comprendre
aux parents que l’autorité parentale s’exerce en commun au quotidien. Le conflit provenant le plus souvent du manque de communication, tout doit être mis en oeuvre pour obliger les parents à échanger, même sur les actes les plus anodins.
En effet, toutes les décisions relatives à l’enfant, fussent les plus banales, doivent être prises d’un commun accord : c’est le sens de l’autorité parentale conjointe et la sphère d’autonomie – à savoir la présomption de l’accord de l’autre parent pour les actes usuels – n’a été prévue que pour éviter la paralysie de chacun dans ses relations avec l’extérieur. Or, c’est précisément ce risque que pourrait
favoriser l’avant-projet de loi. Dans un certain nombre de cas, la réforme rendra donc nécessaire et vraisemblablement plus fréquente une saisine du juge aux affaires familiales, soit pour autoriser un parent à exercer seul un acte déterminé, soit plus radicalement pour substituer un exercice unilatéral à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Alors que beaucoup de conflits se cristallisent après la
séparation sur le choix des activités extrascolaires ou bien sur les principes d’éducation, les parents seront tentés d’invoquer devant le juge cette définition législative. Le « risque d’inflation des contentieux » en matière d’actes usuels et importants, mis en avant par la Fédération nationale de la médiation familiale (FENAMEF) (1) est plus que probable.
C’est, en définitive, toute la logique de l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui pourrait être ainsi malmenée par cette tentative de définition des actes usuels et importants et l’affirmation selon laquelle « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité
parentale » ne pourrait demeurer qu’ une pétition de principe. Par conséquent, comme l’a souligné M. Laurent Gebler, lors de son audition, « il serait également utile de préciser qu’en cas de difficulté d’interprétation des notions d’actes usuels et importants au regard d’une situation spécifique, le principe reste celui du double accord parental, qui doit s’appliquer dans le doute. Une telle disposition
résiduelle permettrait notamment aux administrations (éducation nationale, hôpital, etc.) d’exiger le double accord parental dans certaines situations tangentes ».
● La nécessité d’une définition contestée par les pédopsychiatres
Les pédopsychiatres estiment pour leur part que la définition des actes usuels et importants tombe sous le sens et qu’elle convient seulement à des gens de bonne volonté, prêts à discuter et à convenir d’arrangements. En cas de conflits familiaux, l’un des parents peut toujours être tenté de tout mettre en oeuvre pour s’opposer systématiquement aux décisions prises par l’autre parent.
C’est le sens des propos tenus par le professeur Bernard Gibello, lors de son audition (2) : « Si chacun est de bonne foi et de bonne compétence, cela ne pose aucun problème, et d’ailleurs dans ces cas, la nécessité d’une loi n’est pas évidente ».
b) La modification du mode de délivrance des titres d’identité
Mettant en avant les conséquences graves que la délivrance des titres d’identité ou de voyage peut engendrer si l’enfant quitte le territoire national à l’insu de l’un de ses parents, l’avant-projet de loi subordonne cette délivrance à l’accord des deux parents. Un article 372-3 serait inséré après l’article 372-2 du code civil : « La délivrance d’un titre d’identité ou de voyage requiert l’autorisation des deux parents ».
Actuellement, il s’agit d’un acte usuel, ne nécessitant pas l’accord des
deux parents. À la lumière des auditions réalisées pour préparer ce rapport, il
ressort que la mesure proposée serait susceptible de créer une source de contentieux supplémentaire, permettant des oppositions infondées de la part de l’un ou l’autre parent.
La crainte exprimée à plusieurs reprises est que cette disposition n’offre à chaque parent la possibilité de disposer d’un droit de veto – éventuellement abusif
– sur l’organisation des déplacements de l’enfant avec l’autre, alors qu’il s’agit le plus souvent pour l’enfant, soit de partir en vacances avec l’un de ses parents, soit de conserver des liens avec une partie de sa famille élargie résidant à l’étranger.
En outre, cet article obligerait à l’avenir le juge aux affaires familiales à statuer, le cas échéant, sur le caractère abusif ou non du refus de l’autre parent.
En définitive, certains estiment que pour un enfant menacé d’enlèvement international qui sera éventuellement protégé par le nouveau texte, il se trouvera de nombreux parents gênés par l’obligation de participer ensemble aux démarches nécessaires à la délivrance d’une simple carte d’identité indispensable pour les voyages scolaires de fin d’année. C’est pourquoi, si cette mesure devait être
retenue, il conviendrait alors de prévoir un délai de réponse pour que soit recueilli l’accord de chaque parent pour la délivrance d’un titre d’identité ou de voyage. À l’expiration de ce délai, le silence de l’un des parents vaudrait accord tacite et il pourrait alors être procédé à la production des titres demandés.
c) La clarification du mécanisme d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant
L’inscription de la mesure d’interdiction sur le passeport de l’un des parents étant privée de toute effectivité depuis que le mineur doit avoir son propre passeport, l’avant-projet de loi prévoit de modifier l’alinéa 3 de l’article 373-2-6 du code civil. Le juge aux affaires familiales pourra ordonner une
mesure d’interdiction générale de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation
des deux parents pour une durée maximale de deux ans : « Il peut également
ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans
l’autorisation des deux parents. La durée de cette mesure doit être déterminée par
le juge et ne saurait excéder deux ans. Elle est inscrite au fichier des personnes
recherchées à l’initiative du parent le plus diligent ».
Par ailleurs, en cas d’urgence, un nouveau mécanisme permettrait au parent qui craint un déplacement imminent de son enfant de saisir le procureur de la République afin que celui-ci puisse faire inscrire, sans délai, une mesure d’interdiction provisoire de sortie du territoire au fichier des personnes
recherchées et saisir parallèlement le juge aux affaires familiales. Un quatrième alinéa serait ajouté en ce sens à l’article 373-2-6 du code civil : « En cas d’urgence, le procureur de la République peut ordonner à titre provisoire l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des
deux parents. Il fait inscrire sans délai cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il saisit dans les trois jours le juge aux affaires familiales afin que celui-ci statue sur le fondement des dispositions de l’alinéa précédent. Le juge se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, faute de quoi la mesure ordonnée à titre provisoire par le procureur de la République est caduque. La
décision du juge est communiquée sans délai au procureur de la République, qui fait radier l’interdiction ordonnée à titre provisoire et le cas échéant, inscrire l’interdiction ordonnée par le juge ».
Ces dispositions visent à rendre plus effective la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants, notamment ceux nés de couples binationaux. Cependant comme on l’a vu, avec l’espace Schengen, l’interdiction de sortie du territoire peut aujourd’hui être facilement contournée, l’enfant quittant
le territoire français via un Etat tiers, lui-même membre de l’Espace Schengen.
Demeurera en outre l’écueil du passeport étranger : en effet, le juge aux affaires familiales ne peut en aucun cas exiger l’inscription d’une interdiction de sortie du territoire français sur un passeport étranger.
3. La définition proposée des actes importants peut être retenue plus dans un souci pédagogique que véritablement juridique
Malgré ces limites, l’avant-projet de loi a le mérite de délimiter les actes
importants qui ne peuvent être exercés que d’un commun accord et auxquels les
beaux-parents ne peuvent être associés que par la volonté des deux parents.
● Un souci louable de clarifier le débat sur les actes usuels et importants
La distinction essentiellement pédagogique, opérée par l’avant-projet de loi entre actes usuels et actes importants, permet de définir la liste des actes qu’un parent peut exercer seul, en application de l’article 372-2 du code civil, et, par soustraction, de savoir quels actes doivent obligatoirement être accomplis par les deux parents ensemble. Jusqu’à présent, le seul embryon de classification résultait
de l’article 389-4 du même code relatif à l’administration légale, qui donne pouvoir à chaque parent pour faire les actes « pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation ».
Or plusieurs affaires récentes ont également montré quelques hésitations jurisprudentielles, reflétant par là même les difficultés de cette distinction. Ainsi, la circoncision en constitue un bon exemple : si la circoncision rituelle pratiquée dans les religions juive et musulmane est considérée par la jurisprudence comme un acte important, dans la mesure où elle constitue un signe d’appartenance religieuse ainsi que le choix d’une religion pour l’enfant de manière générale, la circoncision médicalement nécessaire est en revanche considérée comme un acte usuel.
Au-delà de la constante approximation qu’imposent la diversité des situations et l’intimité de la vie familiale, l’avant-projet de loi a donc l’avantage de clarifier le débat en posant une règle générale, assortie d’une disposition particulière. La règle générale serait posée à l’article 372-2 nouveau, aux termes duquel « sont réputés (actes importants) les actes qui engagent l’avenir de l’enfant et qui touchent à ses droits fondamentaux ». La mesure particulière serait celle de l’article 372-3, imposant l’autorisation des deux parents pour la délivrance d’un « titre d’identité ou de voyage ». Certaines associations familiales ont souscrit à la clarification ainsi opérée. L’Union nationale des associations familiales (UNAF) (1) apprécie que l’article premier de l’avant-projet de loi définisse, d’une
part, dans le code civil, les actes importants (2) et qu’il rappelle explicitement, d’autre part, que l’accord des parents est requis pour effectuer de tels actes (3).
Par ailleurs, l’auteur du présent rapport considère que l’un des domaines dans lequel la médiation trouverait utilement à s’appliquer est celui de la prévention du contentieux lié à la détermination des actes usuels et importants. Ne peut-on pas considérer en effet qu’entre les problèmes posés par l’inscription d’un enfant dans une école confessionnelle et une intervention médicale bénigne, il y a
un espace que pourrait occuper utilement la médiation en amont du juge ? Confier cette mission à la médiation familiale offrirait le double avantage, d’une part, de désengorger la justice et, d’autre part, de définir des solutions souples et pragmatiques adaptées à chaque famille. Le médiateur familial, tiers indépendant et impartial, est le mieux à même de pacifier et d’arbitrer, en fonction de chaque
situation familiale, les conflits liés à la définition de ces actes usuels et importants.
● Une réforme de l’interdiction de sortie du territoire plutôt bien accueillie
Si le mécanisme d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur, proposé par l’avant-projet de loi ne résoudra pas pour autant toutes les difficultés, il a été plutôt bien accueilli.
Ainsi, M. Laurent Gebler (4) a tenu à souligner que « l’idée de ne plus faire du passeport (que ce soit celui de l’enfant ou du parent), mais du fichier des personnes recherchées le vecteur d’éventuelles interdictions de sortie du territoire nous semble excellente ». En effet, le dispositif actuel d’inscription sur le passeport parental de l’interdiction de sortie du territoire est privé de toute
effectivité, depuis que le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, prévoit que le mineur doit avoir son propre passeport.
En outre, le magistrat a estimé que « la proposition d’un dispositif permettant au Procureur en cas d’urgence et au juge aux affaires familiales à plus long terme d’ordonner l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire français d’un enfant sans l’accord des deux parents semble tout à fait pertinente
et, en tout cas, beaucoup plus efficiente ». En effet, actuellement, en cas d’urgence, un des parents peut demander auprès de la préfecture l’inscription administrative de sortie de territoire de l’enfant mineur (1), avec toutefois un écueil majeur : la demande peut être faite auprès de la préfecture par un seul
parent et ce sans que celui-ci ait besoin de motiver sa demande.
Les associations familiales, à l’instar de l’UNAF, ont également salué ce renforcement du mécanisme d’interdiction de sortie du territoire des enfants
mineurs : « le dispositif destiné à prévenir les déplacements illicites d’enfants,
avec la création d’une procédure d’urgence, […] va dans le bon sens d’une
protection de la coparentalité ».
Pour ces raisons, l’avant-projet de loi, en clarifiant le mécanisme d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord de ses deux parents, pourrait permettre d’intervenir en amont des déplacements illicites d’enfants.
● Une astreinte simplifiée pour renforcer l’effectivité des décisions du juge aux affaires familiales
La réforme de l’interdiction de sortie du territoire, qui entend donner au Procureur ainsi qu’au juge aux affaires familiales plus de pouvoirs pour lutter contre les déplacements illicites d’enfants, s’inscrit dans une démarche plus générale consistant à renforcer l’effectivité des décisions rendues par le juge en
matière familiale.
À cette fin, l’avant-projet de loi envisage dans son article 3 de permettre au juge aux affaires familiales d’assortir ses décisions – en cas de non représentation d’enfants, par exemple – d’une astreinte et de procéder lui-même à la liquidation de celle-ci, évitant ainsi aux avocats d’avoir à saisir le juge de
l’exécution. Le deuxième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil serait ainsi complété : « Par dérogation aux dispositions des articles 33 à 35 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour assortir la décision qu’il a rendue d’une astreinte. L’astreinte prononcée par le juge aux affaires familiales est toujours liquidée par celui-ci ».Cette possibilité donnée au juge aux affaires familiales de liquider lui même l’astreinte, n’obligeant ainsi plus les parties à saisir le juge de l’exécution, participe d’un souci louable de simplification et d’allègement de la procédure, qui,
selon Mme Marie-Catherine Gaffinel, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris, « est une bonne chose ». En outre, certains praticiens auditionnés ont indiqué que les sanctions civiles étaient particulièrement utiles lorsque l’un des parents, en cas de séparation ou de divorce, ne respectait pas la loi : ainsi, lorsque le juge aux affaires familiales statuera sur l’exercice de
l’autorité parentale, il disposera d’un pouvoir de sanction dissuasif, lui permettant notamment de tenir compte de la manière dont chaque parent respecte l’exercice de l’autorité parentale.
(1) Valable deux mois.
Il convient toutefois de ne pas négliger les risques dont est porteuse une telle proposition. En effet, cette possibilité offerte au juge aux affaires familiales pourrait rencontrer un grand succès, avec une demande systématique de la part des requérants, alors même qu’il existe déjà un large éventail de sanctions pénales (amendes, peines de prison…), notamment pour les situations les plus graves.
Ainsi, le parent qui refuse de restituer l’enfant à la fin des vacances ou des weekends
est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 227-5 du code pénal). De la même manière, il peut être condamné aux
mêmes peines pour soustraction de mineur (article 227-7 du code pénal). C’est d’ailleurs l’existence de ces sanctions pénales qui explique que, dans la pratique,
les juges aux affaires familiales ne recourent que très rarement à la possibilité qui prévaut depuis la loi précitée du 9 juillet 1991 de prononcer des astreintes.
Par ailleurs, la liquidation de l’astreinte par le parent qui n’a pas appliqué la décision du juge aux affaires familiales pourrait générer un important contentieux à caractère financier autour de la personne de l’enfant, alors même que la séparation des parents revêt le plus souvent un caractère conflictuel pour des motifs financiers (pensions alimentaires…). Cependant la proposition de l’avant-projet de loi, consistant à permettre au juge aux affaires familiales de liquider lui-même les astreintes qu’ils prononcent, semble devoir être conservée.
En effet, l’usage plus que modéré dont il est actuellement fait de cette procédure en matière familiale laisse à penser que les risques potentiels, dont cette réforme est porteuse, pourraient ne pas se matérialiser dans les faits.
B. CLARIFIER L’ASSOCIATION D’UN TIERS À L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ
PARENTALE
Dans son souci de faciliter la vie des familles recomposées ou monoparentales, l’avant-projet de loi s’attache également, par-delà la clarification du régime des actes usuels et importants, à circonscrire l’association d’un tiers à l’exercice de l’autorité parentale, en réformant en profondeur la procédure de
délégation-partage de l’autorité parentale, régie actuellement par les articles 377
et 377-1 du code civil.
Contrairement à ce qui a pu être régulièrement affirmé, l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers ne crée aucun statut juridique du beau-parent. D’ailleurs, en France, le beau-parent n’a en principe aucun droit ni aucun devoir envers l’enfant du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit.
Toutefois, rappelons-le, deux dispositions du code civil lui permettent aujourd’hui l’une d’exercer, totalement ou partiellement, l’autorité parentale sur cet enfant et l’autre de partager l’exercice de l’autorité parentale avec l’un des deux parents, voire avec les deux. Ces mesures ne sont pas réservées au beau-parent et peuvent donc être mises en oeuvre au bénéfice d’autres tiers (oncles, tantes, grands-parents, etc.). Dans tous les cas, une décision du juge aux affaires familiales, qui ne peut être saisi que par le ou les parents détenteurs de l’autorité parentale, est nécessaire.
Ainsi, ce texte, loin de bouleverser l’équilibre parental au sein des familles, se propose de mieux distinguer les deux hypothèses, en instituant deux procédures distinctes : la délégation et le partage de l’autorité parentale.
1. La pratique de la délégation et de la délégation-partage de l’autorité parentale
a) La délégation classique, un transfert de l’autorité parentale
● Les conditions de sa mise en oeuvre
La délégation classique de l’autorité parentale, visée à l’article 377, alinéa 1 du code civil, est volontaire car consentie par les titulaires de l’autorité parentale. Ses conditions de mise en oeuvre ont été considérablement assouplies par la loi du 4 mars 2002 : elle peut être prononcée quel que soit l’âge du mineur, alors que la loi du 4 juin 1970 avait fixé la limite d’âge à dix-huit ans et celle du
5 juillet 1974 à seize ans.
Seuls les parents, ensemble ou séparément, peuvent demander au juge aux affaires familiales d’accorder la mesure de délégation, le tuteur ayant perdu cette prérogative. Cela ne signifie pas que l’un des parents puisse évincer l’autre parent au profit de son nouveau partenaire : dans le cas d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les deux parents doivent consentir à la délégation (1).
En revanche, s’il y a exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent peut tout à fait consentir seul à être dépossédé de tout ou partie de son autorité.
L’autre parent devra alors être informé en application de son droit de surveillance.
Il faut enfin rappeler que les parents ne peuvent demander de délégation que « lorsque les circonstances l’exigent » et non à leur simple convenance (2).
En raison de la prohibition des cessions d’autorité parentales, la délégation ne peut intervenir que sur validation du juge aux affaires familiales. Quant au délégataire, il pourra s’agir d’un tiers, membre de la famille ou proche de confiance, d’un établissement agréé pour le recueil des enfants ou d’un service
départemental de l’aide sociale à l’enfance, acceptant de s’occuper de l’enfant. Il convient également de noter que l’article 377 du code civil sous l’empire de la loi du 8 janvier 1993 faisait déjà référence à un « particulier digne de confiance » en opposition aux services administratifs : cette référence, tant sous l’ancienne loi que sous celle du 4 mars 2002, se trouve en tête de l’énumération.
● Ses effets : un transfert total ou partiel d’autorité parentale
En cas de délégation de l’autorité parentale, les parents demeurent titulaires de l’autorité parentale mais sont dépossédés de son exercice au profit d’un tiers. Eux seuls pourront consentir à une adoption ou verser une contribution financière compensant les frais de l’enfant. Ils bénéficient en outre d’un droit de visite et d’hébergement, qu’ils peuvent définir pour les autres membres de la famille si la délégation est partielle ; c’est le délégataire qui y procédera en cas de délégation totale.
Que la délégation soit de droit interne ou consécutive à une Kafala musulmane, les juges considèrent que « l’intérêt de l’enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l’autorité parentale » (1), la mesure étant profondément liée à la proximité de vie avec
l’enfant. Le prononcé étant temporaire, ils pourront retrouver leurs prérogatives (article 372-2, alinéa 1, du code civil).
La délégation peut donc être totale ou partielle : il revient aux intéressés d’en déterminer les modalités au regard de leur situation familiale. Par exemple, la délégation de l’autorité parentale peut être attribuée pour « les actes de la vie courante, les formalités administratives et la gestion du patrimoine de l’enfant » (2). Son caractère partiel répond davantage à l’idée de gestion de la cellule familiale. Le délégataire ne peut exercer que les droits qui lui ont été transmis par jugement, par exemple ceux répondant aux besoins de l’enfant : actes usuels relatifs à l’éducation, ou à la surveillance, autorisation d’un acte chirurgical, droit de consentir au mariage, à l’émancipation, garde de l’enfant... (3)
b) La délégation-partage : un partage sans dépossession de l’autorité parentale
● Les conditions de sa mise en oeuvre
Au sein de la procédure de délégation classique, qui implique le transfert total ou partiel de l’autorité parentale (article 377, alinéa 1, code civil), la loi du 4 mars 2002 a institué une mesure plus souple de délégation-partage ou de « délégation et partage de l’autorité parentale » (4), permettant un partage égal et concomitant des pouvoirs des attributs de l’autorité parentale.
Ainsi, le jugement de délégation de l’autorité parentale peut prévoir que les père et mère ou l’un d’eux – selon les modalités initiales d’exercice, à savoir conjoint ou unilatéral – partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire, sans en être dépossédés, dans le cadre juridique d’une autorité partagée .
La Cour d’appel d’Angers, dans une décision du 11 juin 2004, distingue les fondements de cette délégation de ceux de la délégation classique. Le critère de l’incapacité temporaire à exercer l’autorité parentale ne joue pas ici, seule la volonté de partage importe (1). Il ne s’agit pas toutefois d’un démembrement laissé au bon vouloir des parties : cette délégation ne peut se faire que « pour les besoins d’éducation de l’enfant ». La notion est vaste, sans doute est-il possible d’y
inclure les actes relatifs à la surveillance de l’enfant en tant qu’expression de l’éducation, compris dans la présomption d’accord de l’article 372-2 du code civil : préparation et/ou contrôle des déplacements de l’enfant, des soins à lui apporter, de son hygiène, de son comportement...
● Ses effets : le partage sans dépossession
La délégation-partage de l’autorité parentale emporte plusieurs conséquences.
En premier lieu, la présomption d’accord de l’article 372-2 du code civil est applicable aux actes des délégants et du délégataire. Ainsi, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l’accord des autres, parent et délégataire, lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (par exemple la poursuite d’activités telles le déjeuner à la
cantine, la pratique d’un sport, le contrôle dentaire régulier).
En deuxième lieu, ni la loi ni la jurisprudence ne précisent l’étendue de cette délégation-partage : les modalités du partage sont à définir entre les parties.
La première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas imposé au juge de
définir dans l’acte de jugement les attributs devant être partagés partiellement
(2), ce qui a suscité de vives critiques.
Enfin, la délégation-partage permet l’organisation des rapports entre l’enfant et le couple après la séparation pour les unions hors mariage, particulièrement PACS et concubinage (y compris concubinage homosexuel). Le tribunal de grande instance de Lille a ainsi prononcé une délégation-partage au profit de l’ex concubine de la mère, « la bonne entente des anciennes compagnes
à propos de l’enfant dont elles se partagent les frais d’éducation et d’entretien »
étant établie et les intéressées étant convenues d’une résidence alternée dont l’existence même nécessitait la possibilité de prendre les décisions relatives à l’enfant » (3).
En cas de conflit ou de concurrence entre les parties, le dernier alinéa de l’article 377-1 du code civil prévoit le recours au juge (4) : « Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère public ». Il est cependant raisonnable de penser que le recours à cette délégation présuppose une entente
relative des principaux intéressés, dans la mesure où chacun doit y consentir : « Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale » (article 377-1 du code civil), rendant le recours au juge plus hypothétique.
En définitive, la formule de la délégation-partage, délégation considérée comme volontaire, présente une grande souplesse par rapport aux autres mécanismes : non seulement chaque parent reste titulaire de l’autorité parentale et en conserve l’exercice mais le tiers délégataire dispose d’un titre opposable aux tiers et voit ainsi reconnaître son rôle.
LA PROCÉDURE DE DÉLÉGATION ET DE PARTAGE DE L’AUTORITÉ PARENTALE ISSUE DE
LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE A L’AUTORITÉ PARENTALE
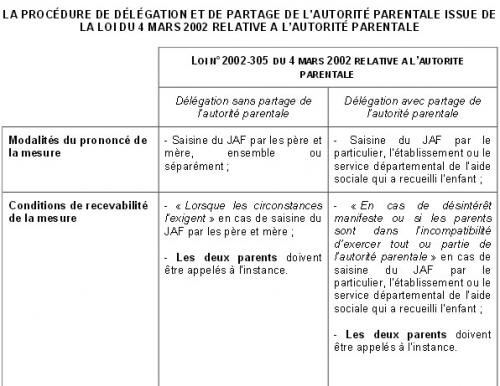
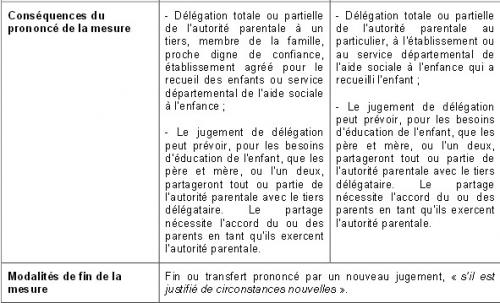
c) Délégation et délégation-partage : des mesures rarement mises en oeuvre
Cependant, qu’il s’agisse de la délégation classique ou de la délégation partage, ni l’une ni l’autre n’ont rencontré un vif succès auprès des familles. En effet, les statistiques du ministère de la justice permettent de dresser un double constat.
D’une part, les demandes de délégation (classique ou avec partage) et de restitution de l’autorité parentale sont extrêmement faibles au regard du nombre total d’affaires civiles relatives à l’autorité parentale et au droit de visite jugées chaque année par les juridictions familiales. En effet, les demandes de délégation et de restitution de l’autorité parentale représentent à peine plus de 3 % des
affaires civiles touchant à l’autorité parentale et au droit de visite.
D’autre part, aucune évolution notable ne peut être observée depuis 2003 :
le nombre de demande de délégation et de restitution de l’autorité parentale n’a connu aucune diminution, ni aucune augmentation significative, attestant ainsi d’une demande stable et marginale.
Ce double enseignement a également été conforté tout au long des auditions par les professionnels rencontrés. En 2008, la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu 55 jugements de délégation (soit 6 à 8 dossiers par mois) sur les 7 460 décisions rendues au fond (soit moins de 0,01 %). Sur ces 55 jugements de délégation, seuls trois comprenaient également
un partage de l’autorité parentale. M. Laurent Gebler (1), juge aux affaires familiales et vice-président du tribunal de grande instance de Libourne, a dressé le même constat dans sa juridiction : « la procédure de délégation-partage de l’article 377-1 est quasiment inconnue des tribunaux de la famille », le tribunal de grande instance de Libourne n’ayant enregistré aucune procédure de ce genre ces
cinq dernières années.
En définitive, le plus souvent méconnue des requérants dans sa version actuelle, l’actuelle procédure de délégation, avec éventuel partage de l’autorité parentale, reste très rarement demandée aux juges aux affaires familiales, pour qui sa mise en oeuvre ne pose au demeurant aucune difficulté particulière.
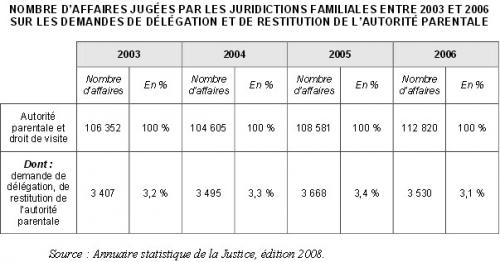
2. Délégation et partage : la mise en place de deux procédures distinctes
« Il est vrai que le dispositif actuel est devenu bâtard, la délégation d’autorité parentale étant devenue selon les circonstances tantôt un mode d’organisation de la vie de l’enfant à l’initiative des parents, lorsqu’elle aboutit à un partage d’autorité parentale entre le délégant et le délégataire, tantôt la
sanction d’un « désintérêt manifeste » (code civil, article 377, alinéa 2), ou encore une manière de confier l’enfant à une personne autre que son parent survivant » (1).
Afin d’y remédier, l’avant-projet se propose de distinguer clairement les deux hypothèses, en instituant deux procédures distinctes : délégation et partage de l’autorité parentale. Selon les circonstances, un parent pourra donc partager l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers, ou le déléguer en tout ou partie.
Dans le premier cas, il n’abdiquera aucun de ses droits ; dans le second, il y renoncera en tout ou partie.
En cas de partage, il soumettra au juge aux affaires familiales une convention que celui-ci homologuera si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant et si le consentement du parent a été donné librement.
En cas de délégation, il saisira le juge aux affaires familiales d’une demande qui statuera en fonction des circonstances. La procédure de délégation, telle qu’elle est envisagée par l’avant-projet de loi, prévoit la possibilité pour le tiers d’agir en justice en cas de décès du parent pour se voir déléguer l’autorité parentale à la double condition que ce tiers ait résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et qu’il ait noué des liens affectifs étroits avec lui .
LA PROCÉDURE DE DÉLÉGATION ET DE PARTAGE DE L’AUTORITÉ PARENTALE DANS
L’AVANT-PROJET DE LOI SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LES DROITS DES TIERS
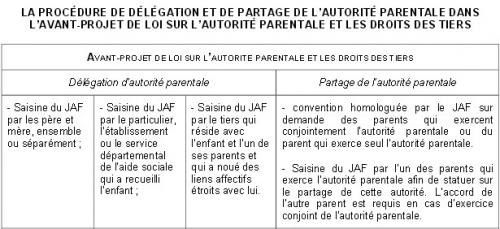


3. Le partage par simple convention homologuée par le juge : des risques non négligeables
L’article 8 de l’avant-projet de loi prévoit le partage de l’autorité parentale par simple convention homologuée par le juge aux affaires familiales sur demande :
— des parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ;
— du parent qui exerce seul l’autorité parentale.
Le principe d’une convention homologuée ne pose a priori aucune difficulté lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale, l’autre parent étant décédé ou défaillant.
En revanche, lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, la convention homologuée par le JAF en matière de partage de l’autorité parentale comporte des risques.
a) La convention : un outil en partie inadapté aux séparations familiales
La convention est adaptée à des parents qui s’entendent bien. Or, dans l’hypothèse d’un partage de l’autorité parentale avec un tiers intervenant lorsque le couple parental se sépare, il est improbable qu’il y ait entente et accord entre les parents pour signer une convention permettant de partager leur autorité parentale avec un tiers. La convention, par l’entente et l’accord qu’elle suppose, convient
davantage à des couples qui ont intérêt à s’entendre pour partager l’autorité parentale, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels, lorsque par exemple ces derniers recourent à une tierce personne pour la fécondation. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si les associations d’homosexuels auditionnées se sont montrées très attachées à cet article. En outre, dans la mesure où le partage de l’autorité
parentale par convention repose sur l’assentiment de toutes les parties (père, mère et tiers), il est fort à parier que, lorsque celles-ci parviennent à s’entendre d’un commun accord sur des modalités partagées d’éducation de l’enfant, elles ne voient pas l’intérêt de recourir à une convention, homologuée ultérieurement par le juge.
b) Des conditions de mise en oeuvre trop imprécises
En modifiant les conditions de mise en oeuvre du partage de l’autorité parentale, l’avant-projet de loi amorce une évolution sensible qu’il convient de souligner : alors qu’actuellement, le partage de l’autorité parentale ne peut être prononcé par le juge que s’il est justifié par « les besoins d’éducation de
l’enfant », cette exigence disparaîtrait, ce qui ne laisse pas d’inquiéter. En effet, nombre de personnes et d’associations rencontrées, à l’instar du Collectif pour l’enfant, y voient une banalisation du partage de l’autorité parentale, potentiellement préjudiciable à l’enfant, dans la mesure où l’intervention d’un tiers, par définition, non parent, dans l’exercice de l’autorité parentale, est une mesure grave pour l’enfant et son équilibre psychologique. En outre, si elle n’est plus justifiée par « les besoins d’éducation de l’enfant », une telle association du tiers pourra très facilement être vécue par l’enfant comme un désengagement de ses parents à son égard et/ou instituera une concurrence avec l’autre parent chez
lequel l’enfant ne réside pas l’enfant(1).
En outre, à l’absence de critères pour partager ab initio l’autorité parentale par convention vient s’ajouter le problème de l’éventuelle dénonciation de la convention qui a présidé au partage de l’autorité parentale. En effet, comme l’a très justement relevé le professeur Yves Lequette (2), il est fort à craindre que « les couples recomposés ne soient pas plus stables que le couple qui a donné naissance à l’enfant, en sorte que celui-ci risque de devenir l’enjeu de la rupture intervenant entre le parent et le compagnon ou le nouveau conjoint avec lequel l’autorité parentale a été partagée ». Pour y remédier, l’avant-projet de loi prévoit, dans son article 8, que le « partage pourra, dans tous les cas, prendre fin
par une convention homologuée par le juge ou un jugement ». Or, si l’accord des parents et du tiers est concevable au départ pour s’entendre sur les modalités de partage de l’autorité parentale, il risque en revanche d’être difficile à obtenir pour dénouer ce partage, les intéressés se trouvant alors dans une situation de rupture et de crise. Souscrivant à l’analyse faite par le professeur Yves Lequette, l’auteur du présent rapport craint qu’ « il faudra fréquemment avoir recours au juge et que l’enfant risque ainsi d’être, juridiquement, directement mêlé aux ruptures sentimentales que pourra connaître chacun de ses parents au cours de sa vie,
voire même d’en devenir l’enjeu ».
c) Le risque d’une insuffisante prise en compte de l’intérêt de l’enfant
Le partage de l’autorité parentale par simple convention pâtit, pour nombre de praticiens rencontrés, d’un manque de garanties procédurales. En effet, en recourant à une convention rédigée à leur seule initiative, les parents pourraient librement s’entendre avec un tiers, au détriment de l’intérêt de l’enfant. La simple homologation de la convention par le juge, quant à elle, risquerait en fait de n’être
qu’une simple validation de celle-ci par le juge a posteriori. Or, comme l’a souligné la Fédération protestante de France, dans sa contribution écrite en date du 29 juin 2009, le partage de l’autorité parentale par simple convention homologuée par le juge « laisse perplexe lorsqu’on sait, qu’en pratique, le contrôle du juge aux affaires familiales, en matière d’homologation de la convention de divorce est
particulièrement restreint et que, bien souvent, le consentement de la partie la plus vulnérable n’a été donné que sous la pression de l’autre ».
d) Le risque d’une dilution de l’autorité parentale
Enfin, le partage de l’autorité parentale par convention homologuée par le juge aux affaires familiales sur demande des parents qui exercent conjointement l’autorité parentale risque de favoriser la multiplication des intervenants successifs dans l’exercice de l’autorité parentale et de facto de multiplier les occasions de conflits, dont l’enfant serait le premier à en souffrir. Comme l’a souligné le
professeur Yves Lequette (1), « il est à craindre que, pour les familles recomposées, cette disposition aboutisse à terme à une multiplication des situations où les parents séparés partagent, l’un et l’autre, l’autorité parentale avec leur nouveau conjoint ou leur compagnon respectif. Serait ainsi remise en
cause l’idée d’une coparentalité qui veut que le couple parental survive à sa séparation. En outre, la multiplication de ces situations risquerait de brouiller gravement les repères des enfants. Mais surtout, il est à craindre que les couples recomposés ne soient pas plus stables que le couple qui a donné naissance à l’enfant, de sorte que celui-ci risque de devenir l’enjeu de la rupture intervenant
entre le parent et le compagnon ou le nouveau conjoint avec lequel l’autorité parentale a été partagée ».
Or, selon les pédopsychiatres, favoriser l’intervention de tiers successifs dans l’exercice de l’autorité parentale participe d’une vision purement sociologique de la famille dont l’écueil principal réside dans l’homogénéisation de toutes les places qu’elle opère aux yeux de l’enfant, à la fois symboliquement et
psychiquement, tout un chacun partageant la fonction parentale.
Alors même que l’enfant a besoin de se situer dans une filiation, l’enfant risque d’être élevé dans l’indifférenciation entre parents et tiers, c’est-à-dire dans une absence complète de continuité généalogique. Selon M. Christian Flavigny (2),
pédopsychiatre, serait ainsi favorisée « une approche superficielle, éducative, de la vie familiale : la spécificité de la place des parents n’y est pas engagée. La relation d’un adulte à un enfant, sans autre spécificité, l’emporterait alors sur la relation d’un parent à son enfant (des parents à leurs enfants) ». Cette préoccupation est également partagée par l’UNAF, qui considère que « ni le phénomène des familles recomposées, ni l’existence de foyers monoparentaux ne doivent conduire à désorganiser la filiation, à affaiblir les principes juridiques de son établissement, à introduire le trouble et l’ambiguïté dans l’identification de ses parents par l’enfant » (3).
Comme cela a d’ores et déjà été mentionné à plusieurs reprises, associer un tiers à l’exercice de l’autorité parentale est une mesure grave, qui ne saurait être fondée exclusivement sur la relation qui existe entre le tiers et le parent de l’enfant. Elle ne peut être justifiée en premier et en dernier ressort que par l’intérêt de l’enfant. L’enfant ne doit en effet pas devenir un prétexte pour conférer un statut de beau-parent au tiers et le droit ne doit pas être utilisé contre l’intérêt de l’enfant, qu’il est initialement censé protéger.
4. Mieux encadrer, dans l’intérêt de l’enfant, le partage de l’autorité parentale par convention
Le recours à la procédure de partage de l’autorité parentale par convention homologuée par le juge ne pourrait être conservé que s’il était assorti d’une double garantie.
En premier lieu, des précautions procédurales, autres que la simple homologation par le juge, doivent être explicitement définies par la loi. Pour ce faire, l’auteur du présent rapport propose que les parents ne pourront rédiger une convention de partage de l’autorité parentale qu’avec l’appui d’un médiateur
familial, tiers indépendant et impartial, qui apparaît être le mieux à même de définir des solutions souples et pragmatiques adaptées à chacune des familles. En outre, l’intervention de cet arbitre dans la rédaction de cette convention empêcherait les parents de s’entendre librement avec un tiers, au détriment de l’intérêt de l’enfant. Il serait le garant du primat de l’intérêt de l’enfant dans le
respect des dispositions légales et réglementaires régissant l’exercice de l’autorité parentale. À ce titre, le juge, lors de l’examen de cette convention pour homologation, devrait tout particulièrement veiller à ce que le médiateur familial ne s’est pas contenté de mettre en forme les desiderata des parents et du tiers au détriment de l’intérêt de l’enfant, dont il est le gardien en dernier ressort.
En second lieu, le partage de l’autorité parentale par convention homologuée par le juge doit, comme c’est le cas actuellement, être justifié par « les besoins d’éducation de l’enfant ». En effet, afin d’éviter toute banalisation de l’autorité parentale et tout désengagement de la part des parents, le partage de
l’autorité parentale ne pourra être homologué par le juge que s’il est justifié par « les besoins d’éducation de l’enfant ».
C’est au prix de ces deux garanties – appui d’un médiateur familial pour la rédaction de la convention et nécessaire justification du partage de l’autorité parentale par les besoins d’éducation de l’enfant – que l’intervention du tiers ne remet pas en cause le primat de l’intérêt de l’enfant.
C. POUVOIR CONSERVER LES LIENS AFFECTIFS TISSÉS ENTRE L’ENFANT
ET UN TIERS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES
Une fois les modalités d’exercice de l’autorité parentale aménagées et le régime des actes usuels et importants clarifié en vue de permettre l’intervention du tiers, l’avant-projet de loi s’attache à renforcer le maintien des liens affectifs tissés entre ce dernier et l’enfant dans des circonstances particulières (décès et séparation).
1. Le maintien systématique des liens entre l’enfant et un tiers : un droit qui comporte certains risques
Afin de rendre effectif le maintien des liens affectifs tissés entre l’enfant et le tiers, l’avant-projet de loi se propose non seulement d’élargir les conditions dans lesquelles le tiers peut se voir confier l’enfant en cas de décès de l’un des parents mais il consacre également un droit intangible de l’enfant au maintien des liens avec le tiers, en cas de séparation de celui-ci et de l’un des parents.
a) L’élargissement des conditions dans lesquelles le tiers peut se voir confier l’enfant en cas de décès de l’un des parents
Lorsque les deux parents sont séparés et que l’un d’eux vient à mourir, la question se pose alors de savoir si l’enfant doit être confié au parent survivant ou de préférence à un tiers. L’article 373-3 du code civil, dans sa rédaction actuelle, pose une règle générale, assortie de deux exceptions.
● La règle générale : la dévolution automatique de l’autorité parentale au parent survivant
La règle générale veut qu’en cas de décès de l’un des parents, la séparation de ces derniers ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale au parent survivant, quand bien même celui-ci aurait été privé, par jugement, de certains attributs de l’exercice de l’autorité parentale.
● Première exception : confier l’enfant à tiers, choisi de préférence dans sa parenté
La première exception à ce principe général est contenue dans le deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil : le juge aux affaires familiales « peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier à
l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté ».
L’article 4 de l’avant-projet de loi propose de supprimer cette préférence accordé au tiers choisi dans la parenté de l’enfant, afin, selon l’exposé des motifs, de « permettre au juge de tenir compte des situations dans lesquelles un tiers – partageant ou ayant partagé la vie de l’un des parents – est présent dans la vie quotidienne de l’enfant et assume sa prise en charge d’une façon constante ».
Nombre d’experts rencontrés, à l’instar de Mme Marie-Catherine Gaffinel, juge aux affaires familiales de Paris (1), ont considéré qu’il s’agissait-là d’une « modification purement textuelle », car, dans la pratique, le juge confie déjà, sur la base de l’actuel article 373-3, alinéa 2, l’enfant à un tiers, parent ou non. Cette modification, pour mineure qu’elle soit, apparaît donc conforme aux pratiques
actuelles. En outre, la suppression de la préférence que conférait le second alinéa à la parenté lorsqu’il faut confier l’enfant à quelqu’un d’autre que son parent survivant ne ferait qu’entériner la jurisprudence qui a déjà préféré une compagne survivante à la soeur d’un père défunt (Cass. 1ère civ., 16 avril 2008), ou un homme dont la paternité avait été contestée par la propre mère de l’enfant (Cass. 1ère civ., 25 février 2009).
Certains pédopsychiatres, comme le docteur Maurice Berger (1), sont en revanche beaucoup plus réservés : le glissement du tiers choisi de préférence dans la parenté de l’enfant vers le tiers, parent ou non, a pour lui « une portée considérable […] parce qu’il existe une importante différence entre les deux au niveau réel et symbolique. Parents et tiers ne s’équivalent pas dans l’esprit d’un enfant et une hiérarchie doit donc être maintenue ». La référence au groupe familial demeurant essentielle et prioritaire du point de vue de la structure psychique de l’enfant, il leur semble nécessaire de conserver une hiérarchie de lien entre les parents et le tiers.
● Deuxième exception : prévoir du vivant même des parents qu’en cas de décès de l’un d’eux, l’enfant sera confié à un tiers
La deuxième exception au principe général précité de dévolution automatique de l’autorité parentale au parent survivant figure au troisième alinéa de l’article 373-3 du code civil : « dans des circonstances exceptionnelles », le juge aux affaires familiales « statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité
parentale après séparation des parents » peut prévoir, « du vivant même des parents », qu’en cas de décès de celui qui exerce seul l’autorité parentale, l’enfant ne sera pas confié au parent survivant et désigner la personne à laquelle l’enfant sera confié.
L’article 4 de l’avant-projet de loi propose que cette décision du juge puisse être prise du vivant des parents même lorsque ces derniers exercent conjointement l’autorité parentale, alors que cette possibilité est actuellement offerte au juge uniquement lorsqu’un seul parent exerce l’autorité parentale. Cette disposition a fait l’objet, lors des différentes auditions, de nombreuses critiques de
la part de praticiens et d’universitaires spécialisés en droit de la famille faisant autorité.
Les juges aux affaires familiales en premier lieu ont exprimé leur inquiétude, soulignant combien il leur était difficile, voire impossible, d’apprécier, par anticipation, l’intérêt de l’enfant pour l’avenir, sauf à ce que la survenance du décès soit très proche. De surcroît, l’hypothèse selon laquelle l’enfant serait confié à un tiers plutôt qu’au parent survivant, même si ce dernier exerçait conjointement
l’autorité parentale avec l’autre parent prédécédé n’est pas exempte de tout
reproche. Comme le souligne Mme Françoise Dekeuwer-Défossez (2), « si un parent s’est vu confier l’exercice conjoint de l’autorité parentale, c’est qu’il a des qualités éducatives telles que l’on ne voit pas pourquoi il serait préférable que l’enfant soit élevé par un tiers. Cette solution aboutit à faire partager l’autorité parentale par un père et un beau-père (ou une mère et une belle-mère), ce qui
peut être source de frictions. Et que faire lorsque ce beau-parent aura trouvé un
nouveau compagnon ? Que sera, par rapport à l’enfant, ce beau-parent à la puissance deux ? Comment sera alors exercée, déléguée, partagée ou dépecée l’autorité parentale entre de multiples tiers, alors que l’enfant a pourtant un parent vivant, qui, par hypothèse, n’aurait pas démérité ? »
b) La généralisation du maintien des liens avec l’enfant en cas de séparation du tiers et de l’un des parents
L’article 6 de l’avant-projet de loi prévoit le maintien de relations personnelles entre l’enfant et le tiers au moment du décès ou de la séparation. Pour ce faire, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Le tiers doit :
— avoir noué des liens affectifs étroits avec l’enfant ;
— avoir résidé avec l’enfant et l’un de ses parents.
Le principe du maintien des relations entre l’enfant et le tiers au moment du décès et de la séparation comporte des risques. Nombre de personnes entendues ont émis de sérieuses réserves sur le postulat qui sous-tend l’article 6 de l’avant projet de loi, selon lequel l’enfant aurait un droit intangible d’entretenir des relations personnelles avec le tiers, seul l’intérêt de l’enfant pouvant en dernier ressort faire obstacle à l’exercice de ce droit.
● Une assimilation contestable avec les droits des grands-parents
Dans sa rédaction actuelle, l’article 6 de l’avant-projet de loi revient à mettre en équivalence complète le tiers avec les grands-parents. En effet, ces derniers se sont vus reconnaître par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.
L’article 371-4 du code civil dispose à ce titre que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».
Or, l’équivalence du tiers avec les grands-parents ignore les différences qui les séparent. Tout d’abord, le tiers peut intervenir brièvement dans la vie de l’enfant, alors que les grands-parents, membres de la famille, présentent une bien plus grande stabilité en raison du lien de filiation.
Ensuite, le précédent des grands-parents n’est pas toujours synonyme de paix. Les juges aux affaires familiales sont en effet très souvent amenés à rejeter les demandes des grands-parents, estimant que leur droit de visite pourrait nuire à l’enfant en ravivant des querelles familiales. On ne peut donc exclure que les demandes des tiers et des beaux-parents présentent les mêmes risques et ne subissent le même sort.
● Des critères de mise en oeuvre ambigus
En outre, les conditions posées à l’exercice de ce droit au maintien des relations personnelles restent trop imprécises et ne sont donc pas en mesure de garantir le primat de l’intérêt de l’enfant. En effet, les critères, que sont la résidence du tiers avec le parent et l’enfant ainsi que l’existence de liens affectifs
étroits, sont très vagues. Ainsi, à partir de quelle durée de résidence, le tiers a-t-il un droit au maintien des relations personnelles avec l’enfant ? La résidence doit elle être continue ou discontinue ? Sur la base de quels critères, le juge aux affaires familiales appréciera-t-il la réalité des liens affectifs étroits tissés entre l’enfant et le tiers ?
● Un dispositif qui ne tient pas assez compte de la réalité
Il convient également de tenir compte du fait que les parents se séparent actuellement avec des enfants de plus en plus jeunes, comme on l’a vu (cf. supra).
Ils rencontrent par conséquent des tiers différents, qui se succèdent et sont ainsi de plus en plus nombreux dans la vie de l’enfant. Ce dernier va donc nouer des relations affectives successives, ouvrant la voie en pratique à autant de droits de correspondance, de visite voire d’hébergement.
Or, le nombre de week-ends et de dimanches, dont dispose l’enfant, est par définition limité et ne peut donc permettre de satisfaire la multiplicité des personnes qui peuvent exiger le respect du droit à l’enfant à un contact avec eux.
Par ailleurs, comme l’a indiqué le docteur Maurice Berger (1), « un des besoins fondamentaux d’un enfant est le besoin de stabilité ». Ce besoin de stabilité paraît de prime abord difficilement conciliable avec la consécration d’un droit de chaque tiers à entretenir des relations avec l’enfant, dès lors qu’il a résidé avec lui et qu’il a noué des liens affectifs avec lui.
Enfin, on peut penser que ce contact du tiers avec l’enfant ne sera pas facilement accepté par le parent, dont il vient de se séparer et avec lequel il a partagé la résidence.
● Une demande qui n’est pas constatée par les juges aux affaires familiales
S’agissant des juges aux affaires familiales, ils estiment qu’il est d’ores et déjà très difficile de garder auprès de l’enfant la place du parent chez qui il ne réside pas, ce qui en retour rend quasiment impraticable l’organisation d’un droit de visite, voire d’hébergement, du tiers. Aussi considèrent-ils qu’il existe un risque important de décomposition de la famille et de dilution des liens de filiation, alors même qu’il n’y a dans les faits que peu de demandes de la part des tiers (cf. infra).
● Un droit contraire à l’intérêt de l’enfant pour les pédopsychiatres
Les pédopsychiatres font valoir pour leur part que les liens affectifs étroits ne sont pas un critère pertinent pour autoriser l’établissement d’un droit du tiers à avoir des relations personnelles avec l’enfant. En effet, un nombre non négligeable d’enfants éprouve une certaine aversion pour la personne qui remplace l’un de leur parent.
Aussi l’avant-projet de loi risque-t-il d’attiser une conflictualité latente dans l’esprit de l’enfant. En outre, si le tiers veut entretenir des relations personnelles avec l’enfant, rien ne prouve que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. En effet, l’intérêt de l’enfant est, selon les pédopsychiatres, d’être protégé et de vivre en interaction avec ses deux parents. Lorsqu’il existe plusieurs figures parentales
autour de l’enfant, celui-ci éprouve par la suite maintes difficultés à nouer des relations avec l’extérieur.
Comme l’a rappelé avec force le docteur Pierre Levy-Soussan,
pédopsychiatre, l’enfant a besoin « de repères symboliques filiatifs avant tout, capable de l’originer en tant que sujet au sein d’une famille » et « de ne pas être
instrumentalisé […] en « objet de bonheur » ou en « objet de reconnaissance ». Il
n’est en effet pas dans l’intérêt de l’enfant de devenir l’instrument par lequel un
adulte satisfait ses seuls desiderata.
c) La demande des tiers : une demande qui est largement surestimée et est déjà satisfaite par le code civil
Non seulement la faculté de confier l’enfant de préférence à un tiers plutôt qu’au parent survivant éloigné de l’enfant(1), pas plus que la consécration d’un droit aux relations personnelles avec le tiers qui a résidé et a noué des liens affectifs avec lui (2)ne sont pas de véritables nouveautés, mais elles font l’objet de très peu de demandes de la part des tiers.
Quant à la possibilité offerte au juge de confier l’enfant à un tiers plutôt
qu’au parent survivant, différents juges aux affaires familiales ont tenu à souligner que la procédure, définie à l’article 373-3 du code civil, demeure compliquée et est très largement méconnue des justiciables, qui, par conséquent, n’y recourent que très exceptionnellement .
S’agissant de la consécration d’un droit de l’enfant aux relations personnelles avec le tiers qui a résidé et a noué des liens affectifs avec lui, ni les personnes rencontrées ni l’auteur de ces lignes ne remettent en cause l’idée selon laquelle, lorsqu’une relation très importante pour l’enfant s’est construite avec le
tiers, il est de l’intérêt de l’enfant que ce lien ne soit pas rompu du jour au lendemain. Mais force est de rappeler que le juge peut d’ores et déjà, à défaut d’accord amiable, organiser le maintien des liens entre l’enfant et ce tiers.
En effet, le second alinéa de l’article 371-4 du code civil prévoit d’ores et déjà dans sa rédaction actuelle le possible maintien des relations personnelles entre le tiers et l’enfant. Il dispose à ce titre que : « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ». Or, faute de demande de la part des tiers, ce dispositif est très rarement utilisé. Ainsi, Mme Marie-Catherine Gaffinel, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris, a constaté qu’en trois ans, elle n’a jamais eu à statuer sur la demande d’un beau-parent en vue de l’obtention d’un droit de visite ou d’hébergement, soulignant que, de manière générale, ces saisines étaient « très rares en pratique ». Sur les dix-sept juges aux affaires familiales que
comprend le tribunal de grande instance de Paris, une seule a été saisie d’une demande en ce sens de la part d’un beau-parent, demande qui sera par ailleurs rejetée au motif qu’elle était contraire à l’intérêt de l’enfant. Me Geneviève Bio Crozet, avocate au barreau de Lyon, a fait le même constat, en affirmant que « le tiers ne demande rien, sauf cas extrêmes qui trouvent leur solution dans les textes ».
En définitive, les réformes initiées par les articles 4 et 6 de l’avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers ne semblent satisfaire aucune demande préexistante.
2. Un intérêt de l’enfant à démontrer et non simplement présumé
S’agissant plus particulièrement de la consécration d’un droit de l’enfant aux relations personnelles avec le tiers qui a résidé et a noué des liens affectifs avec lui, une voie d’apaisement et de consensus semble pouvoir être trouvée autour de l’intérêt de l’enfant.
En effet, en posant le préalable suivant : « Si tel est l’intérêt de l’enfant », l’article 371-4 du code civil dans sa rédaction actuelle souligne bien que l’intérêt de l’enfant à maintenir des relations avec un tiers n’est pas a priori présumé, mais que le tiers demandeur doit effectivement en faire la démonstration.
À l’inverse, l’article 6 de l’avant-projet de loi dispose « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec le tiers qui a résidé avec lui et l’un de ses parents […] Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». Dans ce cas, l’intérêt de l’enfant est présumé d’emblée comme un postulat, alors même qu’il conviendrait de le démontrer pour autoriser ou non le maintien de relations personnelles du tiers avec l’intérêt de l’enfant. Or, cette notion étant par définition malléable et ambivalente, nombre de praticiens entendus ont été fondés à lui contester cette qualité d’évidence préalable que lui prête l’avant-projet de loi.
Par ailleurs, il convient de souligner que la relation qui unit l’enfant au beau-parent est en premier lieu fondée sur la relation affective entre les deux adultes. Ainsi, si cette relation affective vient à disparaître, la relation entre l’enfant et le tiers s’en trouvera nécessairement affectée : le juge devra alors examiner la situation à la lumière de l’intérêt de l’enfant, sans que celui-ci ne soit
présumé.
Pour ces raisons, afin que le juge garde un entier contrôle de l’intérêt de l’enfant et qu’il prenne des mesures souples, s’adaptant à toutes les situations de fait sans dogmatisme, il apparaît plus sage de préférer à l’article 6 de l’avant projet de loi la rédaction actuelle de l’article 371-4 du code civil. En effet, le droit existant, par sa souplesse et sa simplicité, permet au juge d’apprécier les situations
au cas par cas, sans pour autant présupposer l’existence d’un droit intangible de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec un tiers. Par là même il assure une meilleure protection de l’intérêt de l’enfant.
Fin de la Deuxième Partie
TROISIÈME PARTIE
L’INTÉRÊT DE L’ENFANT AU SEIN
DES CONFLITS ENTRE ADULTES DOIT ÊTRE REPENSÉ
DANS LE CADRE DE LA MÉDIATION FAMILIALE
Parce que le droit n’a pas vocation à régir l’ensemble des situations
particulières et parce que chaque famille, pour préserver son équilibre, a besoin de
solutions souples et pragmatiques, il apparaît indispensable de développer le
recours à la médiation familiale, judiciaire et extrajudiciaire. Celle-ci peut
contribuer à la fois à déplacer le conflit sur d’autres terrains que celui de la
revendication autour de la personne de l’enfant et à permettre aux parents
d’élaborer un mode de communication au quotidien plus adapté à l’intérêt de
l’enfant.
A. LA MÉDIATION FAMILIALE : UNE MESURE RÉCENTE DESTINÉE À
FAVORISER LA COPARENTALITÉ ET A PRÉVENIR LES CONFLITS
1. La médiation familiale : une démarche juridique permettant de pacifier les conflits familiaux dans l’intérêt de l’enfant Inscrite dans la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la médiation familiale a pour objectif, avec l’aide d’un tiers indépendant, d’aider les parents à l’exercice consensuel de l’autorité parentale en prévenant les conflits (médiation extrajudiciaire) ou en atténuant leurs effets dans l’intérêt des enfants (médiation judiciaire).
a) La médiation familiale dans le code civil
Introduite dans le code civil par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale et renforcée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 réformant le divorce, la médiation judiciaire est aujourd’hui encadrée par deux articles du code civil :
— l’article 255 du code civil relatif au divorce, qui dispose que « le juge
peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir
recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation » ;
— l’article 373-2-10 du code civil relatif à l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, qui dispose qu’ « en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une
mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».
b) Les missions dévolues à la médiation familiale
Conformément à la définition adoptée par le Conseil national consultatif de la médiation familiale le 22 avril 2003, « la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de
rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».
Chargée de rétablir le fil rompu du dialogue ainsi qu’un climat de confiance, la médiation familiale poursuit un triple objectif : restaurer la
communication ; préserver et reconstruire les liens entre les membres de la famille et prévenir les conséquences d’une éventuelle dissociation du groupe familial ; donner les moyens aux personnes de chercher par elles-mêmes, dans le respect de leurs droits et obligations respectifs, des issues à leur situation, qu’elle relève ou non du champ judiciaire.
La médiation familiale fait l’objet d’un partenariat entre les ministères chargés de la justice et de la famille et la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour financer et structurer, au niveau départemental, un maillage territorial suffisant. Un processus de professionnalisation des médiateurs a abouti en 2003 à la création d’un diplôme d’État spécifique de médiateur familial mais la
création tardive, en 2006, du Comité national de suivi de la médiation familiale et l’implication financière modeste (cf. infra) du ministère de la justice n’ont, pas facilité la mise en place des comités départementaux de suivi de la médiation familiale.
c) Les publics visés par la médiation familiale
Sont principalement concernés par la médiation familiale trois types de public :
les couples ou parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce,
les grands-parents souhaitant préserver des liens avec leurs petits-enfants et
les jeunes adultes en rupture de liens avec leurs parents.
Si les parties prenantes à un conflit familial (parents, grands-parents, etc.) peuvent s’adresser directement à un médiateur familial, le juge aux affaires familiales peut toujours proposer, au cours de la procédure judiciaire, une médiation familiale. Quelle que soit la personne ayant eu l’initiative d’une mesure de médiation, le processus de médiation doit impérativement présenter un caractère volontaire, confidentiel, et librement consenti.
Si ce triple critère est respecté, la médiation peut intervenir à différentes étapes de la vie familiale : avant ou pendant une séparation, afin de la préparer et d’anticiper ses conséquences ; après la séparation, lorsque les décisions antérieurement prises ne correspondent plus aux besoins des parties, à ceux des enfants ou bien à la situation de départ ; à tout moment d’un conflit familial susceptible d’entraîner une rupture et une dissolution du groupe familial.
d) Le déroulement d’une mesure de médiation familiale
La médiation familiale se déroule en trois étapes.
En premier lieu, un entretien d’information gratuit au cours duquel le médiateur familial présente aux
familles les objectifs, le contenu et les thèmes qui peuvent être abordés est organisé.
À ce stade, les familles peuvent accepter ou bien refuser de s’engager dans une mesure de médiation familiale et ce, en toute connaissance de cause, cet entretien d’information étant sans engagement de leur part.
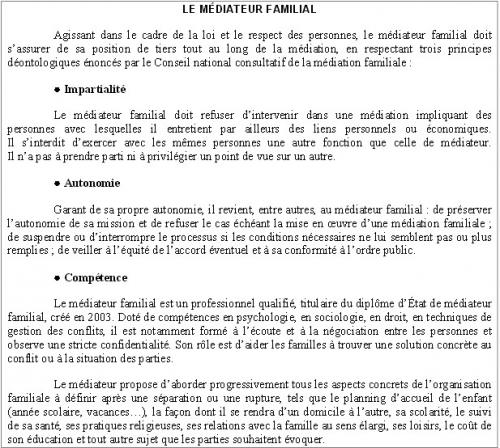
En deuxième lieu, une fois que les familles ont accepté la mesure de médiation familiale, sont organisées les différentes séances de médiation, qui donnent lieu à des entretiens. D’une durée moyenne comprise entre une heure trente et deux heures, ces séances se déroulent sur une période de trois mois, renouvelable une fois(1). Il convient à cet égard de noter que le nombre de séances par mesure de médiation varie suivant la situation des parties et les sujets qu’elles souhaitent aborder. Le médiateur familial peut recevoir les personnes individuellement ou ensemble, le même temps de parole leur étant imparti. Si c’est le juge qui a ordonné la médiation familiale avec l’accord des parties, celles-ci
peuvent bénéficier, selon leurs ressources, de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire une prise en charge totale ou partielle du coût de la médiation par l’État. Si tel n’est pas le cas, les séances sont réglées par les justiciables eux-mêmes selon des tranches allant de 5 à 132 euros conformément à un barème national établi par la CNAF.
Enfin, intervient la dernière étape de la mesure de médiation familiale, si les parties parviennent à un accord écrit, détaillant les différents points d’entente pour l’avenir. Elles peuvent d’ailleurs, le cas échéant, demander au juge de l’homologuer pour qu’il lui donne force exécutoire. Quoiqu’il en soit, le principe de confidentialité prévaut et, à ce titre, aucun rapport sur le contenu des entretiens de médiation n’est adressé au juge.
2. La médiation familiale à l’épreuve des faits : des services éparpillés et mal financés pour un rôle encore trop marginal
Cependant, cette procédure récente n’a pas encore bénéficié des moyens
qui lui permettent d’atteindre complètement ses objectifs.
a) Une inégale répartition des services de médiation familiale sur le territoire national
« L’empilement de dispositifs dispersés géographiquement et sans articulation entre eux, le défaut d’une réflexion sur l’accès des parents à l’information, ne peut garantir une réponse adéquate et une prise en charge globale des besoins des familles. » faisait valoir la Cour des comptes dans son
rapport public annuel pour 2009. De fait le dispositif de médiation familiale, dont la gestion est déconcentrée, n’échappe pas à ce constat sévère.
Répondant aux observations faites par la Cour des comptes dans son rapport annuel 2009, le ministère de la justice a toutefois reconnu que « la répartition des services sur le territoire national est inégale. À titre d’exemple, la cour d’appel de Bastia dispose de deux associations, alors que la cour d’appel de
Paris en compte vingt-quatre. Par ailleurs, dans le ressort de cette dernière cour, la répartition est telle que si la ville de Paris dispose de douze services, les départements de la Seine-Saint-Denis et de l’Essonne ne comptent chacun que deux associations. La cour d’appel de Metz qui couvre un seul département, compte sept associations, alors que la cour d’appel de Colmar, qui couvre deux
départements, dispose de quatre services.
Cependant, à l’exception d’Angoulême, Morlaix, Dax et Saverne, les tribunaux de grande instance disposent tous soit d’un (1) Il est admis une moyenne de 7 entretiens pour une mesure de médiation familiale service de médiation familiale, soit d’un service d’espace de rencontre ou des
deux à la fois ».
Au 30 juin 2009, l’annuaire de la Fédération nationale de la médiation
familiale recensait 196 associations et organismes adhérents, assurant la gestion de
196 services de médiation familiale et de 210 antennes de médiation familiale (1),
ce qui représente 406 lieux d’exercice de la médiation familiale en France.
(1) Il est admis une moyenne de 7 entretiens pour une mesure de médiation familiale.
RÉPARTITION DES 406 LIEUX D’EXERCICE DE LA MÉDIATION FAMILIALE PAR RÉGION

Ce tableau sur la répartition, par région, des services et antennes de médiation familiale montre à quel point le dispositif de médiation familiale ne répond pas aux besoins d’un maillage satisfaisant : cinq régions sur vingt-trois –
Corse, Aquitaine, Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur –
concentrent près de 60 % (2) des services et antennes de médiation familiale. Ainsi, sur les 406 services ou antennes de médiation familiale, le ministère de la justice a indiqué que 37 structures ont pris en charge moins de 10 mesures dans l’année, 30 services n’ont pris en charge que 10 à 20 mesures. À peine 5 structures dépassent les 100 mesures.
Or, comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2009, «l’éparpillement des services de médiation familiale augmente leur coût de fonctionnement et leur concentration devrait être encouragée ». Dans cette perspective, répondant aux observations de la Cour, le ministère de la justice, a indiqué que « la mutualisation de la gestion administrative des services, ceux-ci
étant souvent de petite taille, pourrait être une solution. Le groupement des services en est une autre, mais le mouvement associatif n’y semble aujourd’hui pas spontanément disposé ».
En outre, il doit être remédié à la dispersion des structures par un pilotage efficace du dispositif, tant au niveau national que local. Ainsi, afin de renforcer ce pilotage à l’échelon local, ont été mis en place, en février 2007, des comités départementaux de développement et de coordination de la médiation familiale.
Ces comités se composent de représentants de la CAF, de la DDASS, de la MSA, de la Justice (1) ainsi que du conseil général. À l’échelon national, le pilotage du dispositif est assuré, depuis 2006 par le Comité national de suivi de la médiation familiale.
(1) Les antennes organisent des entretiens de médiation familiale.
(2) Les régions Corse, Aquitaine, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Île-de-France concentrent
58,4 % des services et antennes de médiation familiale.
b) Des financements éparpillés et fragiles
Selon la CNAF, le coût de la médiation familiale aurait été de 11,7 millions d’euros en 2006, tous financeurs confondus, dont 7 millions assumés par la branche famille, 1,5 million par les collectivités territoriales et seulement 0,86 million d’euros par le ministère de la justice (2). Selon la CNAF, la faiblesse des crédits du ministère de la justice conduirait les juges à orienter les parents vers
la médiation judiciaire mais la maigre prescription des mesures judiciaires peut en retour justifier la faiblesse de l’engagement financier de la Chancellerie.
Pour pérenniser ce dispositif de médiation familiale, dont le besoin s’accroît, la Cour des comptes, dans son rapport public annuel pour 2009, a rappelé que « l’élaboration d’un tarif de la prestation constitue un impératif ». En effet, le financement des services de médiation représenterait actuellement environ
40 % des charges réelles de fonctionnement, ce qui peut provoquer l’abandon de l’activité ou faire porter l’effort sur des parents en conflit et s’avérer alors dissuasif.
On peut légitimement s’interroger sur le coût réel de la médiation familiale. Pour ce faire, la CNAF raisonne en termes de postes et non de séances.
Ainsi, le prix de revient moyen d’un service médiation familiale en 2007 correspond à un équivalent temps plein, soit 73 348 euros. Alors que ce sont 12 120 mesures de médiation – judiciaire et extrajudiciaire – qui ont été réalisées en 2007 et 175 équivalents temps plein (ETP) qui ont été financés la même année, le coût annuel de médiation familiale peut être estimé, au 1er janvier 2009 (1), à
12,8 millions d’euros (2) et le coût d’une mesure de médiation à 1 059 euros (3).
Le Conseil national consultatif de la médiation familiale a, pour sa part, procédé à une estimation du coût de la médiation familiale sur l’ensemble du territoire, suivant le nombre de médiateurs par département.
(1) Le ministère de la Justice est représenté dans chaque comité par le magistrat délégué à la politique
associative et à l’accès au droit de la cour d’appel.
(2) Source : rapport public annuel 2009 de la Cour des comptes, p. 637.

L’objet pour 2004 était d’arriver à couvrir le territoire français en ayant deux médiateurs familiaux à temps complet par département, soit 200 médiateurs familiaux assurant 14 000 mesures de médiation par an. Alors qu’une projection pour 2007-2008 évaluait à 33 000 le nombre de mesures de médiation familiale réalisées sur l’ensemble du territoire, le nombre de mesures réalisées n’a été que
de 12 210 en 2007.
c) Un rôle encore trop marginal
En dehors de ces difficultés et de ces insuffisances, il faut admettre que le recours à la médiation familiale n’a pénétré que très timidement notre culture de résorption des conflits. Comme l’a écrit le Médiateur de la République, dans son rapport annuel pour 2008, « force est de constater que la médiation familiale judiciaire, dont beaucoup d’observateurs et de praticiens reconnaissent les
mérites, joue encore un rôle très marginal dans le processus de traitement de ces conflits ».
Loin d’être isolé, ce constat est partagé par M. Serge Guinchard qui, dans son rapport intitulé « L’ambition d’une justice apaisée » (4), a souligné que « la médiation bénéficie d’un succès mitigé ». En effet, la médiation en matière civile n’est ordonnée que dans 1,5 % des affaires traitées par les cours d’appel et 1,1 % des affaires traitées par les juridictions du premier degré. Comme le rappelle
M. Serge Guinchard, la médiation « est surtout utilisée en matière familiale où elle a concerné, en 2006, 5 095 tentatives extrajudiciaires et 3 710 renvois en médiation par le juge ; ces chiffres, mis en regard des quelque 360 000 affaires soumises aux juges aux affaires familiales, démontrent que la médiation, même dans ce domaine, peine à prendre une place à la hauteur des apports de cette
institution ».
La Chancellerie fait sienne cette opinion. Répondant aux observations de la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2009, elle a souscrit au constat d’une sous-utilisation du dispositif de médiation familiale par les juridictions, comparativement, notamment aux espaces rencontres : 4 437 mesures de
médiation familiale judiciaire contre 17 692 mesures concernant le droit de visite parents/enfants en 2007.
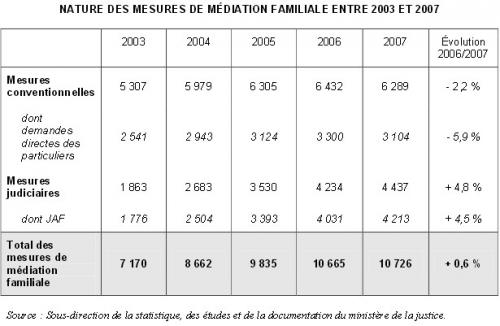
Au cours de l’année 2007, les associations de médiation familiale ont dispensé 5 716 séances d’information générale, 10 206 entretiens d’information préalables ayant débouché ou pas sur une médiation et 23 397 entretiens de médiation familiale.
Mais au-delà de ces obstacles culturels, on peut se demander si les freins opposés à cette pratique ne trouvent pas leur source dans les textes mêmes. Pour le ministère de la justice (1), « le faible nombre de mesures de médiation familiale ordonné par les juges s’explique essentiellement par le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les mesures judiciaires de médiation familiale. En effet, les articles 255 et 373-2-10 du code civil subordonnant la mise en oeuvre de la médiation à l’accord préalable des parties, le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir d’imposer cette mesure. Il peut seulement enjoindre les parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la mesure ».
Dans ce contexte, la Chancellerie estime qu’il n’est guère surprenant que le nombre de médiations judiciaires ne soit pas très élevé : « Les magistrats ne prononcent pas d’injonctions de rencontrer un médiateur lorsque les parties ne paraissent pas d’emblée prêtes à accepter l’idée d’une médiation, dans la mesure où cela rallonge la procédure sans garantie aucune que la médiation pourra apporter une solution au conflit ». Enfin, il convient d’observer qu’au stade de la procédure où elle est susceptible d’intervenir, la médiation judiciaire n’est pas toujours envisageable, le juge aux affaires familiales étant souvent saisi à un moment où le conflit est cristallisé et où les parties refusent toute idée de dialogue.
Afin de lever les différents obstacles qui pèsent aujourd’hui sur le développement de la médiation familiale, plusieurs réformes ont d’ores et déjà été entreprises. Comme le rappelle la Cour des comptes, « la branche famille a engagé plusieurs chantiers pour améliorer ce dispositif (analyse des activités,
revalorisation de la prestation de service, convention de financement pluriannuelle et multi-partenariale), mais leur réussite suppose un réengagement des autres partenaires ». De son côté, le ministère de la justice a indiqué que la mise en place d’un dispositif d’évaluation générale de la médiation familiale est actuellement en cours d’étude dans le cadre des travaux du Comité national de
suivi de la médiation familiale avec l’ensemble des autres co-financeurs.
B. FAVORISER LE RÈGLEMENT EN AMONT DES QUESTIONS LIÉES AUX
ENFANTS GRÂCE À LA SYSTÉMATISATION DE LA MÉDIATION
FAMILIALE
Nombreuses sont aujourd’hui les voix qui appellent de leurs voeux un renforcement de la médiation familiale, tant judiciaire qu’extrajudiciaire, afin, de déplacer le conflit sur d’autres terrains que celui de la revendication autour de la personne de l’enfant et de pacifier les conflits familiaux. En effet, ceux-ci ont davantage besoin d’une procédure conduisant à un exercice consensuel de l’autorité parentale que de nouvelles dispositions juridiques, inaptes à régir un ensemble des situations très différentes les unes des autres et susceptibles de générer un contentieux que l’on cherche par ailleurs à tarir pour d’évidentes motivations budgétaires. Pour ce faire, on peut considérer que deux voies pourraient être privilégiées : d’une part, conforter et soutenir la médiation familiale judiciaire et, d’autre part, développer le champ de la médiation extrajudiciaire obligatoire.
1. Encourager le recours à la médiation familiale judiciaire
Afin d’encourager le recours à la médiation familiale judiciaire, deux actions pourraient être menées en parallèle : le développement d’une véritable « culture de médiation » et la généralisation de la pratique de la « double convocation » en matière de contentieux familial.
a) Développer la « culture de médiation »
Dans son rapport annuel pour 2008, le Médiateur de la République avait exprimé le souhait que soit confortée la médiation familiale judiciaire, afin d’ « apaiser les conflits familiaux et (de) favoriser une coparentalité responsable ». La commission sur la répartition des contentieux a pour sa part fait
observer, dans son rapport déjà cité que la montée en puissance de médiation familiale « ne pourra résulter que d’une démarche volontariste, passant notamment par la mise en place de mécanismes incitatifs », rappelant au passage « combien la diffusion de la culture de la médiation [est] nécessaire au développement des voies amiables de résolution des conflits ». Or, pour être effective, cette culture « doit être partagée par l’ensemble des acteurs du monde judiciaire, magistrats, avocats et personnels de greffe ».
Si certains jugent que la médiation familiale n’est pas encore pleinement entrée dans la pratique quotidienne des juridictions, certaines d’entre elles toutefois ont mis en place des dispositifs innovants afin d’encourager le recours à la médiation judiciaire. Ainsi, dans certaines juridictions, des médiateurs
proposent une information gratuite sur l’objet et le déroulement du dispositif.
Dans d’autres, dès le dépôt des requêtes en séparation et divorce, des greffes
invitent les couples à se renseigner sur la médiation.
Au-delà de ces actions de sensibilisation et d’incitation à la médiation, le Tribunal de grande instance de Paris a souhaité généraliser ce genre de pratiques.
Depuis janvier 2007, une permanence d’information sur la médiation peut accueillir les couples sur injonction du juge aux affaires familiales. « Entre 2007 et 2008, il y a eu 67 % d’augmentation des injonctions à rencontrer un médiateur familial, prononcées par les juges. Cela veut dire que maintenant la médiation familiale fait partie du paysage des juges aux affaires familiales », observe
Mme Danièle Ganancia, vice présidente et juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Paris. En définitive, cette permanence a conduit 80 % des couples, après leur passage à la permanence de médiation familiale, à accepter d’entamer une médiation. Au regard des résultats ainsi obtenus, on ne peut que plaider en faveur d’une généralisation des permanences d’information à la
médiation familiale auprès de chaque tribunal de grande instance.
Afin de permettre à l’ensemble des acteurs judiciaires d’un conflit familial d’orienter à bon escient les familles vers un médiateur, le présent rapport recommande également que magistrats, greffiers et avocats soient spécialement sensibilisés à la médiation familiale. Cette action de sensibilisation auprès des magistrats revêt une importance toute particulière car la culture du juge ne doit pas
uniquement être celle de trancher les litiges. Au titre de ses missions, il lui revient également de concilier les parties.
Souscrivant pleinement aux recommandations faites par la commission présidée par M. Serge Guinchard, l’auteur du présent rapport considère que le développement d’une culture de la médiation à l’échelle locale passera dès lors nécessairement, d’une part, par l’établissement d’ « une liste de médiateurs par tribunal de grande instance » et, d’autre part, par la mise en place d’ « un référent
au sein de chaque tribunal de grande instance. Il est en effet nécessaire d’intégrer au mieux les organes de médiation. Un magistrat référent, qui constituerait un pont entre la juridiction et les services de médiation, apparaît la condition indispensable au développement de relations de confiance mutuelle qui s’imposent entre un délégant et son délégataire ».
b) Consacrer la pratique de la « double convocation »
En novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a mis en place une procédure dite de « double convocation ». Ainsi, en cas de saisine du juge aux affaires familiales, non précédée d’une tentative de médiation, les parties, dès saisine de la juridiction, sont renvoyées devant un médiateur familial, sans recueil formel de leur accord, tout en leur donnant une date d’audience, soit aux fins d’homologation de leur accord, soit aux fins de jugement (1).
Soulignant l’intérêt d’engager les parties dans une logique de médiation en parallèle de la procédure judiciaire, Mme Danièle Ganancia, vice présidente et juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Paris a précisé que « souvent les personnes trouvent un accord dès l’entretien d’information chez le médiateur. Dès la première audience, le juge peut homologuer l’accord ». Cette
expérimentation a également été menée avec profit au Tribunal de grande instance de Bobigny, en matière familiale, où, pour les affaires sélectionnées par les magistrats, elle a abouti dans la moitié des cas à un accord, total ou partiel.
Toutefois, comme l’a fait observer M. Serge Guinchard, « le succès de la double convocation passe par un lien étroit entre la juridiction et les services de médiation concernés, à l’effet d’assurer une permanence de médiateur ».
Par conséquent, pour les actions ne relevant pas du champ de la médiation obligatoire préalable à toute action en justice (cf. infra) et à l’exclusion du divorce, il serait nécessaire de consacrer les pratiques existantes de double convocation. En pratique, le juge aux affaires familiales pourrait, pour toute
affaire, inviter les parties à rencontrer un médiateur avant même l’audience, voire dès l’enrôlement de l’acte introductif d’instance.
Les modalités selon lesquelles une médiation pourrait être proposée s’en trouveraient assouplies, permettant ainsi que le développement de la médiation judiciaire n’induise pas un allongement de la durée des procédures. La souplesse autorisée par ce mécanisme permettrait d’apporter une réponse adaptée à chaque affaire soumise au juge .
(1) Il convient de préciser qu’aucune conséquence ne peut être tirée par le juge d’un défaut de passage devant
le médiateur familial, étant que l’accord des deux parties n’a pas été préalablement recueilli.
2. Développer le champ de la médiation extrajudiciaire obligatoire
Le rapport précité sur la répartition des contentieux considère à juste titre que « le champ familial constitue le terrain de prédilection de la médiation en matière civile. Le primat de l’intérêt de l’enfant commande en effet que soit privilégiée à la démarche contentieuse la démarche amiable, « tant l’autorité parentale doit être envisagée – comme la terminologie retenue par le droit
communautaire nous y invite – sous l’angle de la responsabilité parentale ». La responsabilité et le dialogue qu’impose l’exercice quotidien de l’autorité parentale, surtout en cas de séparation, justifient que l’on s’interroge sur la systématisation de la médiation familiale préalablement à la saisine du juge aux affaires familiales.
L’expérience menée depuis plus de dix ans au Québec est à cet égard très
éclairante.
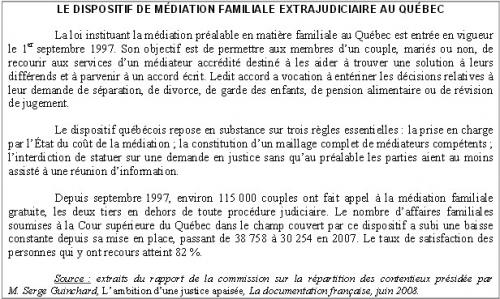
a) Systématiser le recours à la médiation préalable pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice .
Adhérant aux propositions faites en la matière par la commission sur la répartition des contentieux, l’auteur du présent rapport suggère que la médiation préalable à toute action en justice devienne obligatoire pour les actions tendant à modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice, ce qui concerne plus de 70 000 affaires par an (fixation
et modification des modalités de visite et d’hébergement ou de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant). Systématisée pour toutes les actions récurrentes tendant à modifier une décision du juge aux affaires familiales portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la médiation familiale préalable obligera les parents, avant toute saisine du juge, à s’inscrire, avec l’aide d’un médiateur, dans une démarche de dialogue leur permettant d’ajuster eux mêmes
les modalités d’exercice de leur autorité parentale dans le seul intérêt de leur enfant.
L’encouragement au dialogue et au pragmatisme, que favorise la médiation préalable aux actions tendant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, peut trouver deux terrains d’élection privilégiés : le partage de l’autorité parentale et la définition des actes usuels et importants.
En premier lieu, comme l’auteur du présent rapport l’a déjà souligné, si le principe d’une convention homologuée par le juge peut être retenu en matière de partage de l’autorité parentale, il convient de prévoir en contrepartie que les parents ne pourront rédiger cette convention qu’avec l’appui d’un médiateur familial, tiers indépendant et impartial, le mieux à même de définir des solutions
souples et pragmatiques adaptées à chacune des familles. Par ailleurs, l’intervention de cet arbitre, qu’est le médiateur familial, empêchera les parents de s’entendre librement avec un tiers au détriment de l’intérêt de l’enfant : le médiateur sera alors le garant du primat de l’intérêt de l’enfant dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant l’exercice de l’autorité parentale.
En second lieu, la médiation extrajudiciaire préalable aux actions tendant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale trouverait utilement à s’appliquer en matière de prévention des contentieux liés à la détermination des actes usuels et importants. Le médiateur familial, tiers indépendant et impartial, est le mieux placé pour pacifier et arbitrer, en fonction de chaque situation
familiale, les conflits liés à la définition de ces actes usuels et importants.
Cependant, à l’instar de ce que préconise M. Serge Guinchard dans son rapport, il semble pertinent de réserver la médiation familiale préalable obligatoire aux seules actions visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et non à les déterminer d’emblée. En effet, « ces demandes concernent des problématiques plus complexes, n’intéressant pas seulement l’enfant et justifiant bien souvent, dans un contexte conflictuel, qu’une décision intervienne rapidement pour régler les modalités de la séparation des parents ». Dans ce cadre, la médiation aurait vocation à régler essentiellement des problèmes pratiques sans avoir un champ d’application trop large. On peut donc estimer qu’en dehors des actions visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parties doivent simplement être incitées à recourir à la médiation, grâce notamment à la procédure dite de « double convocation » ou bien à la permanence d’information de la médiation familiale auprès de chaque tribunal de grande instance (cf. supra).
Ainsi, le caractère impératif de la médiation familiale préalable visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale emporterait plusieurs conséquences.
Tout d’abord, l’introduction de la demande devant le juge aux affaires familiales devrait obligatoirement être précédée d’une réunion d’information gratuite sur la médiation menée sous l’égide d’un médiateur familial. À l’image de ce que propose la commission sur la répartition des contentieux, cette réunion d’information préalable à toute action en justice ne serait pas obligatoire dès lors
que le demandeur serait en mesure de justifier d’un motif grave interdisant tout recours à la médiation (contexte de violences, urgence, défaut de présentation d’une partie devant le médiateur, etc.).
Ensuite, pour être pleinement efficace, cette exigence d’une réunion d’information préalable à toute action en justice « serait prescrite à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par le juge et non régularisable en cours d’instance ».
Enfin, la réunion d’information préalable obligatoire à toute action en justice doit nécessairement être gratuite, sauf à constituer une entrave à l’accès à la justice, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si les parties, après la réunion
d’information préalable, décident d’engager une procédure de médiation, on rappellera qu’elles pourront à ce titre bénéficier selon leurs ressources de l’aide juridictionnelle et que la participation financière des personnes faisant l’objet d’une médiation sera calculée selon leurs revenus. Ces règles seraient compatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui affirme
que si l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme garantit un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives aux droits et obligations à caractère civil, les États jouissent d’une marge d’appréciation en la matière. La détermination des « obligations positives » des États au regard du caractère effectif du droit au recours en ce qui concerne l’accès au tribunal
s’apprécie par rapport à plusieurs critères : la spécificité du recours, le fait que l’affaire ait déjà fait ou non l’objet d’un examen en fait et en droit, la nécessité de permettre l’exécution des décisions dans un délai raisonnable. Une aide publique à l’accès au juge (CEDH 7 juillet 1977 Airey c/ Irlande n° 3289/73) ne constitue pas par ailleurs un droit absolu, une condition de plafond de ressources du bénéficiaire
ayant été jugée conforme à la convention, compte tenu des exigences liées aux finances de l’État (CEDH 10 juillet 1980 X. c/Royaume-Uni n° 8158/78) et si le coût de la mesure n’est pas disproportionné par rapport aux ressources du requérant. Au surplus en termes purement financiers nationaux, on peut penser que les gains générés par la médiation supporteraient aisément la comparaison
avec les dépenses qu’implique un recours systématique au juge.
b) Créer un dispositif public de médiation familiale extrajudiciaire
Si, comme cela vient d’être démontré, la médiation préalable à toute action en justice gagnerait à se développer, afin d’amener les parents à fixer et à ajuster eux-mêmes les modalités d’exercice de leur autorité parentale dans le seul intérêt de leur enfant ; elle ne remplira toutefois cette nouvelle fonction qu’en se détachant, via la création d’un dispositif public de médiation familiale extrajudiciaire, de la régulation judiciaire, assurée par les juridictions.
L’exemple précité du Québec a permis de mettre en évidence que, pour être performante, la médiation doit bénéficier d’une organisation structurée en dehors du cadre judiciaire. S’associant aux propositions faites par la commission sur la répartition des contentieux, l’auteur du présent rapport suggère que le
développement souhaité en France de la médiation préalable en matière familiale soit conforté par la création d’un dispositif public de médiation familiale extrajudiciaire.
En effet, « l’expérience québécoise révèle que le développement de la médiation familiale ne peut se concevoir sans une prise en charge financière, totale ou partielle, par l’État ». Si le diplôme d’État de médiateur familial et les centres et services de médiation constituent les premières ébauches de ce dispositif public de médiation familiale extrajudiciaire, « une organisation publique semble
indispensable dans le contexte national, tant pour garantir la présence de services de médiation familiale sur l’ensemble du territoire, que pour assurer la qualification et le contrôle des médiateurs, ainsi que la prise en charge financière de la médiation ». On rejoindra encore une fois l’analyse de la Commission sur la répartition des contentieux, qui évoque la nécessité de s’appuyer sur l’expertise
acquise dans ce domaine par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse de mutualité sociale agricole, tout en veillant à l’étroite association de l’ensemble des partenaires naturels de cette politique, que sont les ministères de la justice et des affaires sociales ainsi que les collectivités territoriales.
La mise en place d’un dispositif public de médiation familiale extrajudiciaire ne pourra toutefois voir le jour sans une volonté politique forte et un budget en conséquence. Il est cependant nécessaire d’évaluer en contrepartie l’économie financière générée par le recours à la médiation, qui permet de
désengorger les tribunaux. Afin de répondre au mieux aux besoins, il conviendrait
d’expérimenter ce dispositif, avant de le généraliser.
Fin de la Troisième Partie et de l'article.
Ajouter un commentaire